 Un
demi-siècle
à l'abandon ! Un demi-siècle à ciel
ouvert ! L'église Saint-André en a
forcément souffert. Des objets, des élements
liturgiques ont disparu. Il a bien fallu les remplacer avant de la
rendre
au culte. Entrons maintenant dans l'église...
Un
demi-siècle
à l'abandon ! Un demi-siècle à ciel
ouvert ! L'église Saint-André en a
forcément souffert. Des objets, des élements
liturgiques ont disparu. Il a bien fallu les remplacer avant de la
rendre
au culte. Entrons maintenant dans l'église... « Ego te
baptizo in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti... » Les
fonts baptismaux où je fus ondoyé
le dimanche 21 juin 1953 n'étaient pas
d'origine. Les vrais gisaient, paraît-il, dans la cour d'une
ferme de
Carville-la-Folletière. Qui nous dira pourquoi. De
même
l'autel roman primitif avait-il disparu ainsi que les enduits
intérieurs. Souvenir du temps où la
maison de Dieu n'accueillait plus de brebis. Mais du blé.
« Ego te
baptizo in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti... » Les
fonts baptismaux où je fus ondoyé
le dimanche 21 juin 1953 n'étaient pas
d'origine. Les vrais gisaient, paraît-il, dans la cour d'une
ferme de
Carville-la-Folletière. Qui nous dira pourquoi. De
même
l'autel roman primitif avait-il disparu ainsi que les enduits
intérieurs. Souvenir du temps où la
maison de Dieu n'accueillait plus de brebis. Mais du blé.© Marc Ribès
Le bénitier présente les mêmes motifs de style gothique tardif que les boiseries du confessionnal ou encore de la chahaire à prêcher. Dans les années 60, lorsque vous entriez dans l'église, vous trouviez sur votre droite, tout près du bénitier, ce que l'on appelait "le banc des pauvres". Forcément, les garnements dont j'étais s'y dissipaient durant l'office. Sauf le jour où l'abbé Coupel fit cette annonce : la messe était en mémoire de ma mère...
Voici le confessionnal. Initialement posté à l'entrée du chœur, il a été relégué en fond d'église lorsque furent installés des bancs plus larges. Incarnant le pardon et la miséricorde, sainte Madeleine surplombe la boîte à malices pour guider le pénitent sur le chemin du le pardon divin. Vous me pardonnerez ce ton badin. C'est celui d'un enfant des années 50 qui, croyez-le bien, conserve un profond respect pour ce lieu sacré...
Je me souviens de ces séances où, à tour de rôle, nous débitions nos turpitudes à l'abbé Coupel. Il fallait se creuser la tête pour dresser la liste de nos mauvaises actions et justifier ainsi le déplacement. Nous lui réservions les plus bénignes. Les vraies. les inavouables, nous les gardions pour nous. Aujourd'hui, comme il y a prescription, vous dire que j'ai dérobé un rouleau de réglisse quand Madame Bidaux avait le dos tourné me soulagera le cœur.
 Arrivé
votre tour, la
dureté l'agenouilloir vous pressait
déjà d'en finir. Silence. Le rideau s'ouvrait
subitement et l'on devinait la tête du curé d'Ars
derrière le
treillage de bois. Un murmure à peine perceptible
relançait l'interrogatoire. Enfin, d'une voix plus
ferme,
l'abbé Coupel
vous délivrait les genoux : ""Je te pardonne tes
péchés au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit..." Son aboslution accordée, le
curé prononçait la sentence. Alors, pour
vous dégourdir les jambes, vous alliez réciter
face à l'autel un nombre de Notre
Père et de Je
vous salue Marie
proportionnel à la gravité des vos
péchés. Bien sûr, on en bredouillait
l'air. Pas les paroles. Il fallait simplement calculer le temps
correspondant à la condamnation mais de toute
façon, l'abbé Coupel s'occupait
déjà d'un autre
client.
Arrivé
votre tour, la
dureté l'agenouilloir vous pressait
déjà d'en finir. Silence. Le rideau s'ouvrait
subitement et l'on devinait la tête du curé d'Ars
derrière le
treillage de bois. Un murmure à peine perceptible
relançait l'interrogatoire. Enfin, d'une voix plus
ferme,
l'abbé Coupel
vous délivrait les genoux : ""Je te pardonne tes
péchés au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit..." Son aboslution accordée, le
curé prononçait la sentence. Alors, pour
vous dégourdir les jambes, vous alliez réciter
face à l'autel un nombre de Notre
Père et de Je
vous salue Marie
proportionnel à la gravité des vos
péchés. Bien sûr, on en bredouillait
l'air. Pas les paroles. Il fallait simplement calculer le temps
correspondant à la condamnation mais de toute
façon, l'abbé Coupel s'occupait
déjà d'un autre
client.
Pas plus qu'à l'arithmétique du maître d'école socialisant, je ne comprenais pas grand-chose aux mystères de la religion détenus par le curé. Mais je reconnais que l'un comme l'autre avaient le même talent talent pour m'embrouiller la tête. Alors, durant la messe, mon regard se perdait dans la voûte en bois, avec ses quatre grandes poutres traversières ornées de poinçons sculptés.
La sainte des auto-tamponneuses
 La
statuaire qui peuplait Saint-André nous était
familière. Ces personnages de pierre, tous pour la
plupart
du XIXe s. semble-t-il, ne tenaient pas en place du fait de leur
jeunesse. Avant de s'installer près de la porte
d'entrée,
Marie et Madeleine, toujours inséparables, encadraient
l'autel
principal. L'une du côté de l'épitre,
l'autre
à droite. Sainte Madeleine, on
la
retrouvait aussi sur les vitraux En
Seine-Maritime, elle dispose de neuf églises à
son nom et
de trois chapelles. Reste à expliquer pourquoi est-elle
fêtée chez nous.
La
statuaire qui peuplait Saint-André nous était
familière. Ces personnages de pierre, tous pour la
plupart
du XIXe s. semble-t-il, ne tenaient pas en place du fait de leur
jeunesse. Avant de s'installer près de la porte
d'entrée,
Marie et Madeleine, toujours inséparables, encadraient
l'autel
principal. L'une du côté de l'épitre,
l'autre
à droite. Sainte Madeleine, on
la
retrouvait aussi sur les vitraux En
Seine-Maritime, elle dispose de neuf églises à
son nom et
de trois chapelles. Reste à expliquer pourquoi est-elle
fêtée chez nous.Photo : Jean-Claude Quevilly.
En tout cas elle nous était franchement sympathique. C'est sous son vocable qu'était placée la fête foraine. Les manèges, les auto-taponneuses, c'est à Marie-Mad que l'on devait les tickets ! Qu'elle en soit bénie à jamais...
Dans la nef...
A mi-chemin de l'allée centrale se tient une véritable garderie d'enfants. Dans une niche, sur votre gauche, se tient une vierge à l'enfant. Un plâtre peint dans le style Napoléon III. En face saint Antoine de Padoue, tenant lui aussi dans ses bras l'enfant Jésus.
 Mais
ces statues n'ont pas toujours été à cet
emplacement. On peut même dire qu'elles nous aurons fait la danse
de saint Guy. Ici, à gauche, sainte Madedeleine fait face
à saint Roch.
Mais
ces statues n'ont pas toujours été à cet
emplacement. On peut même dire qu'elles nous aurons fait la danse
de saint Guy. Ici, à gauche, sainte Madedeleine fait face
à saint Roch. Un peu plus loin, encadrant l'entrée vers le chœur, la vierge à l'enfant se dresse sur l'autel qui lui est dédié. Saint Joseph surmonte quant à lui son propre autel.
 Un,
deux, trois soleil ! Quand on se retourne sur cette seconde photo prise
à une autre époque, nos facétieuses statues ont
encore changé de place. Sainte Marie se tient dans la niche du
mur nord avec, à ses pieds, son autel dédié.
Joseph est dans la niche sud, lui aussi surmontant son autel.
Dotés de tabernacles, ces deux tables sacrées ont disparu
lorsque l'on a doté l'église de bancs plus larges.
Un,
deux, trois soleil ! Quand on se retourne sur cette seconde photo prise
à une autre époque, nos facétieuses statues ont
encore changé de place. Sainte Marie se tient dans la niche du
mur nord avec, à ses pieds, son autel dédié.
Joseph est dans la niche sud, lui aussi surmontant son autel.
Dotés de tabernacles, ces deux tables sacrées ont disparu
lorsque l'on a doté l'église de bancs plus larges.
| Un
autel de sainte
Marie est attesté de longue date dans l'église
d'Yainville On y avait aussi
fondé au
moyen-âge une
chapelle dite de Gelleville. Cest le nom d'un fief
situé dans la paroisse de Bosbénard-Cresey. Un
certain Jean Poisson en fut un temps le chapelain Avant la travée sous clocher rayonnait au dessus de nos têtes un Christ en croix, datant, paraît-il, de 1811. Mais d'où venait-il puisque l'église fut rouverte bien plus tard ? En tout cas, il n'a pas bougé. Le revêtement de sol est un pavage daté du XIIIᵉ siècle classé en tant qu'objet depuis le 18 juillet 1908. Voûtée en bois, la charpente comporte quatre entraits avec des poinçons sculptés. (Photo Hubert Vézier). |
Les vitraux
En 1845, pour la réouverture au culte, les six baies latérales actuelles ont été percées dans un style roman, remplaçant des ouvertures antérieures, dont certaines gothiques, dans une volonté d’unification architecturale.
| Ces
baies ont vraisemblablement été garnies dans un
premier temps de
vitrerie simple, en verre blanc ou orné de motifs
géométriques. Ce
n’est que plusieurs décennies plus tard, entre
1875 et 1895, que furent
installés les vitraux figuratifs encore visibles
aujourd’hui. On y retrouve encore notre sainte Madeleine, le personnage emblématique de la pénitence chrétienne : Sainte Madeleine au pied de la Croix, dans une attitude de compassion, Puis une Méditation de sainte Madeleine, la représentant en prière, selon l’iconographie traditionnelle de la sainte retirée dans la grotte. Photos
: J.-C. Quevilly
Cliquer pour agrandir |
Le chemin de Croix
Ce fut notre première BD, un peplum comme on allait en voir au cinéma Le Paris de Caudebec. Les couleurs sont franches : tons bleus à l'arrière plan, rouge chaud de la robe du Christ. On ne voit que lui parmi ces personnages disposés quasi-symétriquement. Quant au visage doux des femmes, ils ont une touche Raphaëlienne.
Photographiées dans les années 1980 par Jean-Claude Quevilly, les toiles du chemin de Croix nécessitaient restauration. Ce qui a été fait...
Bien plus tard, en août 1998, dans une église du centre de la France, j'ai eu la surprise de découvrir exactement les même toiles. Les mêmes !... C'était à Castelnau-Pégayrols.
 Quoi, un
atelier les avaient donc peintes en série alors que je les
croyais
uniques ! Retrouver là, en Occitanie, entre
Sauveterre-de-Rouergue et La
Canourge
les images de mon
enfance normande
m'a fait tout drôle. J'ai glissé un
mot sous la porte de l'historien
local pour lui signaler ce jumelage. Qu'il aura peut-être
estimé d'une grande banalité. Car ces
mêmes images
se retrouvent partout en France et on le doit à la maison
Beau.
Quoi, un
atelier les avaient donc peintes en série alors que je les
croyais
uniques ! Retrouver là, en Occitanie, entre
Sauveterre-de-Rouergue et La
Canourge
les images de mon
enfance normande
m'a fait tout drôle. J'ai glissé un
mot sous la porte de l'historien
local pour lui signaler ce jumelage. Qu'il aura peut-être
estimé d'une grande banalité. Car ces
mêmes images
se retrouvent partout en France et on le doit à la maison
Beau.Depuis, j'en ai su beaucoup plus sur le chemin de Croix d'Yainville. De style néo-classique avec des éléments baroquisants, le même est présent dans toute la France.
Le grand tableau

Seize tableaux décoraient l’église à la fin de l'ancien régime, dont deux de grand format : l’un représentant Jésus-Christ, l’autre la Sainte Vierge. Tous auront disparu à la Révolution.
 La
toile
maîtresse de notre musée à nous
était accrochée sur l'arc triomphal, à
la base du clocher pour être bien visible des
fidèles assis dans la nef. La décision d'acheter
un
tableau fut adoptée par le conseil municipal en 1882. La
commune
y mettait 100 F, le conseil de fabrique 50. Finalement, Yainville
reçut ce don de l'Etat en 1884, Jules Grévy
était alors président de la
République.
La
toile
maîtresse de notre musée à nous
était accrochée sur l'arc triomphal, à
la base du clocher pour être bien visible des
fidèles assis dans la nef. La décision d'acheter
un
tableau fut adoptée par le conseil municipal en 1882. La
commune
y mettait 100 F, le conseil de fabrique 50. Finalement, Yainville
reçut ce don de l'Etat en 1884, Jules Grévy
était alors président de la
République. Photo: J.-C. Quevilly.
Ce tableau est une copie du Salavor Mundi de Bernardino Luini, peintre lombard de la Renaissance, proche du cercle de Léonard de Vinci. Sauveur du monde, le Christ lève la main droite en signe de bénédiction. Il tient dans la main gauche un globe surmonté d'une croix, symbole de sa souveraineté sur la terre comme au ciel. L’inscription latine en bas renforce le message spirituel : POSCE NE DVBITA QVOD QVODCV PATRI IN NOMINE NE PETIERIS FIET TIBI, Demande, ne doute pas, tout ce que tu auras demandé au Père en mon nom, il sera fait à toi, ce qui s'inspire de l'Evangile selon saint Jean.
Arthur Barnouvin (1838-1900) est l'auteur de cette réplique. Formé aux Beaux-Arts de Paris, élève de Flandrin et de Lecoq de Boisbaudran, Barnouvin était un ami de Rodin. C'est en réalisant le portrait de la sœur du sculpteur que celle-ci lui déclara sa flamme. Hélas, s'excusa aussitôt Barnouvin, il était promis à une autre. Maria Rodin partit alors s'ensevelir dans un couvent.
Par ses copies de maîtres anciens, ce peintre prolifique a prêté son concours à de nombreux dons de l'Etat pour doter notamment les petites églises rurales. Lorsque fut prise cette photo, la toile se trouvait en fort mauvais état de conservation.
La chaire à prêcher
 Collée
au mur sud,
elle est en bois sombre, richement travaillée dans un style
néo-gothique, reconnaissable aux arcs trilobés et
aux
motifs en forme de trèfles ou de quadrilobes.
Collée
au mur sud,
elle est en bois sombre, richement travaillée dans un style
néo-gothique, reconnaissable aux arcs trilobés et
aux
motifs en forme de trèfles ou de quadrilobes. Le garde-corps de l’escalier suit un tracé élégant, avec des panneaux décorés uniformément jusqu’à la cuve, elle-même surmontée d’un abat-voix en bois sculpté couronné d'une croix.
Le travail du bois témoigne d’un savoir-faire artisanal remarquable réalisé sans doute en atelier.
Les sermons de l'abbé Coupel furent pour les cancres que nous étions l'occasion de nous familiariser avec le chinois. Autant dire que nous n'y comprenions rien. Notre attention se reportait donc sur la pluie de postillons généreusement aspergée par notre pasteur. De l'eau bénite !
L'abbé grimpait en chaire après l'Evangile pour prononcer son sermon. Aucune de ses paroles ne m'est restée en mémoire. Rien que la musique. Un ton catastrophiste. Après quoi l'abbé enchaînait le prône et les annonces. Puis il regagnait l'autel pour le Credo, signe de notre retour imminent à une vie normale.
De faux saints
 Au-dessus
du confessionnal, quand celui-ci était près du
chœur, trônait un saint Jean adossé
à la
façade nord. Mais était-ce le
Baptiste ou l'Évangéliste ? La question sera vite
tranchée. Il s'agissait en fait
d'une
statue du Christ assis en majesté et sur le socle de
laquelle
avait
été gravé "St Jean".
L'inscription éronnée fut
opérée au XIXe
siècle. Avec une écriture droite
caractéristique
de l'époque, elle ne présentait pas les signes
d'usure de
la statue qui, elle est estimée entre la fin du
XIIIe siècle et le XVe. Propriété de
la Commune,
cette effigie sacrée de 72 cm de haut a
été
inscrit à titre d'objet le 31 octobre 1989. Depuis, on lui a
refait un socle tout neuf, sans gravure cette fois. Ainsi le
Christ peut-il bénir les foules avec son
calice sans qu'il soit pris pour un subalterne.
Au-dessus
du confessionnal, quand celui-ci était près du
chœur, trônait un saint Jean adossé
à la
façade nord. Mais était-ce le
Baptiste ou l'Évangéliste ? La question sera vite
tranchée. Il s'agissait en fait
d'une
statue du Christ assis en majesté et sur le socle de
laquelle
avait
été gravé "St Jean".
L'inscription éronnée fut
opérée au XIXe
siècle. Avec une écriture droite
caractéristique
de l'époque, elle ne présentait pas les signes
d'usure de
la statue qui, elle est estimée entre la fin du
XIIIe siècle et le XVe. Propriété de
la Commune,
cette effigie sacrée de 72 cm de haut a
été
inscrit à titre d'objet le 31 octobre 1989. Depuis, on lui a
refait un socle tout neuf, sans gravure cette fois. Ainsi le
Christ peut-il bénir les foules avec son
calice sans qu'il soit pris pour un subalterne.
La travée sous clocher
 Entre
la nef
et le chœur se situe la travée sous
clocher.
Un espace carré avec ses deux arcs en plein cintre à
angles vifs et à simple rouleau reposant sur des pilastres
rectangulaires par l'intyermédiaire de simples impostes
changreinées. C'est une
zone de
transition entre la nef et le chœur, entre les
fidèles et
l'officiant entouré de son
état-major : l'organiste, le bedeau, les clergeots...
Entre
la nef
et le chœur se situe la travée sous
clocher.
Un espace carré avec ses deux arcs en plein cintre à
angles vifs et à simple rouleau reposant sur des pilastres
rectangulaires par l'intyermédiaire de simples impostes
changreinées. C'est une
zone de
transition entre la nef et le chœur, entre les
fidèles et
l'officiant entouré de son
état-major : l'organiste, le bedeau, les clergeots... L'harmonium fut tenu par un Traiton, André Rouget, puis vers 1953 vint Liliane Vian. Elle cèdera la relève à fille Véronique peu avant 1980.
On distingue au dessus de la porte menant à la sacristite un arc en plein ceintre qui a té comblé. Cette ouverture donnaît-elle directement sur l'extérieur où une annexe sommaire ? Photo : J.-C Quevilly
Sur le pilier droit du premier arc, près de l'esclier de la chaière à prêcher, sont vissées des plaques votives. "Reconnaissance à Ste Thérèse LH 1940", "Merci à Ste Thérèse, 1944 - BL "...Deux ont été retirées dont une pour orner le socle de la statue de sainte Thérèse.Saint André et saint Martin son adossés de part et d'autre du second arc. André a aussi sa plaque : " Reconnaissance à St André de nous avoir protégé tous. GB". Un peu plus loin sur le pilier de la voûte se lit une sixième plaque : "Reconnaissance au Sacré Cœur, JB 1941". Je ne sais quel fut son rôle sous l'Occupation, mais sans doute fut-il remarquable.
Cet espace est éclairé par le grand vitrail gothique aménagé au XVIe siècle. Sous cette baie est percée une ouverture plus sommaire. On y voit aussi une étroite tribune de bois protégeant l''escalier qui conduit à la chambre des cloches.
Vue du cœur, et non des fidèles, apparaît la porte de la sacritie ajouée en 1845. Pendant l'office, le bedeau s'asseyait devant son entrée, adossé à la voûte sur une chaise à fond de paille.
On lit dans la pierre une ancienne ouverture avec une arcature en plein cintre, typique du style roman, des claveaux visibles, sans doute en tuffeau ou calcaire plus clair. Cette ouverture a été condamnée sans doute lors de la restauration de 1845. Elle donnaît directement sur l'extérieur où une structure qui a disparu.
La tribune en
bois nous évoquait une autre chaire à
précher datant du moyen-âge. Nous allions trop au
cinéma. Elle protège
l’accès à l’escalier qui
monte à la chambre des cloches. De son socle, saint
André surveille l'opération.
Les peintures décoratives
|
La travée sous clocher abritait aussi des peintures décoratives plutôt rares. Elles ont disparu. Celles que vous voyez donc ci-dessous constituent donc des documents.
 C'est
le cas de ce détail d'un zodiaque relevé au XIXe
siècle sur l'intrados de l'arc du sanctuaire. On y voit un
homme s'adonnant aux travaux agricoles. Datée du XIIIe
siècle,
c'est donc la plus vieille représentation connue d'un
Yainvillais. Quand son dessin est reproduit, on ne connaît
que deux
églises en France ayant un zodiac pour décoration
murale
: Yainville et Saint-Loup-de-Naud. Ils ont
été effacés par le temps. A droite est
reproduit un
rinceau tracé sur la face de l'arc du chœur. En
dessous
se voit un tracé d'appareil. Enfin ci-contre est un dernier
rinceau. C'est
le cas de ce détail d'un zodiaque relevé au XIXe
siècle sur l'intrados de l'arc du sanctuaire. On y voit un
homme s'adonnant aux travaux agricoles. Datée du XIIIe
siècle,
c'est donc la plus vieille représentation connue d'un
Yainvillais. Quand son dessin est reproduit, on ne connaît
que deux
églises en France ayant un zodiac pour décoration
murale
: Yainville et Saint-Loup-de-Naud. Ils ont
été effacés par le temps. A droite est
reproduit un
rinceau tracé sur la face de l'arc du chœur. En
dessous
se voit un tracé d'appareil. Enfin ci-contre est un dernier
rinceau. Après ces fragments reproduits au XIXe siècles, des restes de peintures décoratives ont été reconnus lors de la restauration de 1953. Elles figuraient des bordures avec entrelacs. Bien que très fragmentaires, d'un décor peint au XIIIe siècle. |
Non mais c'est qui le patron !
 Nous
sommes encore dans la travée sous clocher, juste avant de
pénétrer dans le chœur proprement dit.
A gauche de
l'évangile, la
statue de
saint André, en pierre polychrome, avec sa croix en bois,
occupe la
place d'honneur. 1,15 m de hauteur, 35 cm de large, elle daterait du
XVIe et fut classée au titre des Monuments Historiques le 31
octobre 1989.
Nous
sommes encore dans la travée sous clocher, juste avant de
pénétrer dans le chœur proprement dit.
A gauche de
l'évangile, la
statue de
saint André, en pierre polychrome, avec sa croix en bois,
occupe la
place d'honneur. 1,15 m de hauteur, 35 cm de large, elle daterait du
XVIe et fut classée au titre des Monuments Historiques le 31
octobre 1989.
Mais qui donc est le patron d'Yainville ? André, né à Bethsaïde en Galilée, exerçait avec son frère Pierre le métier de pêcheur. Il s'attacha d'abord à saint Jean-Baptiste puis fut le premier disciple choisi par Jésus. Quand le Christ revient de Jérusalem, il voit André et Pierre pêchant dans le lac. Il les fait alors pêcheurs d'hommes. Après la mort de Jésus, André prêche l'évangile en Grèce, en Asie... Et fut crucifié à Patras, en Achaïe. L'Église a toujours manifesté une forte dévotion à saint André qui reste comme l'un des douze apôtres du Christ. Au Moyen Âge, de la Grèce à la Russie en passant par l'Écosse, la Bourgogne il est le saint patron de foule de contrées. En France, l'expansion de son culte s'accompagne d'une iconographie considérable.
Photo. J.-.C. Quevilly
La
fête
de saint André, célébrée le
30 novembre, est apparue au IVe siècle.
Elle fut longtemps marquée à Yainville. A titre
d'exemple, le 8 décembre 1894, Jean-Louis Claudet, Bance, son
adjoint et tout le conseil assistèrent à une messe
dominicale célébrée par l'abbé Sode suivie
d'un vin d'honneur salle des mariages.
Précédée d'une vigile et suivie d'une
octave, elle
revêtait une
grande importance. Le 9 mai, on commémorait aussi
la
translation
de sa
dépouille, en 357, à Constantinople. Saint
André
était également
invoqué dans diverses formules liturgiques. D'origine
grecque, Andreas
signifiant homme fort, vaillant, le prénom André
s'est diffusé dans
l'antiquité tardive grâce à
l'apôtre. S'il fut cependant peu prisé par
les Chrétiens, André fut un prénom
très porté à Yainville. Ma
mère
s'appelait Andréa en souvenir d'un frère mort
avant elle, André est mon
troisième prénom et mon petit-fils se
prénomme Andréas. Tradition respectée.
 A
droite de l'évangile est
l'évêque saint Martin avec sa crosse.
Saint Martin ! Quand nous étions gamins, nous croquions des
biscottes
Clément. Sur un côté du paquet, il y
avait une image représentant
Martin, à cheval, glaive en main, coupant en deux son
manteau rouge de
soldat romain pour en vêtir un pauvre. Après ce
geste, cet enfant de la
noblesse aux parents païens fut appelé par Dieu,
connut le martyr et
mourut évêque de Tours, affublé de
mille miracles. C'est à ses pieds
que des générations de Yainvillais se sont fait
baptiser. Fêté le 11
novembre, Martin est l'un des saints les plus populaires depuis les
années 400. En Seine-Maritime, 161 églises, onze
villages lui sont
dédiés. Il était invoqué
pour tout dans le pays de Caux: le carreau, la
patte d'oie, la stérilité. C'est le protecteur
des chevaux, des
ouvriers du cuir et des chandeliers. Le mal de saint Martin, c'est
aussi cette propension a bessailler plus que de
raison. "A la saint Martin, l'hiver est
en chemin. Finis ton
grain, bois le vin. Et laisse l'eau au moulin..." J'ai suivi
le conseil à la lettre.
A
droite de l'évangile est
l'évêque saint Martin avec sa crosse.
Saint Martin ! Quand nous étions gamins, nous croquions des
biscottes
Clément. Sur un côté du paquet, il y
avait une image représentant
Martin, à cheval, glaive en main, coupant en deux son
manteau rouge de
soldat romain pour en vêtir un pauvre. Après ce
geste, cet enfant de la
noblesse aux parents païens fut appelé par Dieu,
connut le martyr et
mourut évêque de Tours, affublé de
mille miracles. C'est à ses pieds
que des générations de Yainvillais se sont fait
baptiser. Fêté le 11
novembre, Martin est l'un des saints les plus populaires depuis les
années 400. En Seine-Maritime, 161 églises, onze
villages lui sont
dédiés. Il était invoqué
pour tout dans le pays de Caux: le carreau, la
patte d'oie, la stérilité. C'est le protecteur
des chevaux, des
ouvriers du cuir et des chandeliers. Le mal de saint Martin, c'est
aussi cette propension a bessailler plus que de
raison. "A la saint Martin, l'hiver est
en chemin. Finis ton
grain, bois le vin. Et laisse l'eau au moulin..." J'ai suivi
le conseil à la lettre.
Photo. J.-.C Quevilly
Le chœur"Un autel de pierre contemporain de l'édifice" est encore visible en 1871, note alors l'abbé Cochet. Quelque temps après, l'église a été "dépouillée de son autel roman" constate l'abbé Tougard en 1879. Du coup, par une délibération du 20 février 1881, on lui substitua la structure néo-gothique en bois que j'ai connue, étant enfant de chœur. Nous prenions place sur les bancs qui épousaient les courbes de l'abside et encadraient la table sacrée. Pour souligner l'importance liturgique de l'autel, il est surélevé par deux marches. Quant au tabernacle en forme de tourelle, il s’inspire de l’architecture gothique et symbolise la demeure du Christ eucharistique. Par sa hauteur et son élévation, il évoque la "tour de David" des Litanies, image de force et de sainteté. Il rappelle que l’autel est le cœur du sanctuaire où se manifeste la présence réelle de Dieu.
L'autel a retrouvé sa simplicité biblique primitive. Vatican II est passé par là pour retourner le prêtre vers ses ouailles.
| L'ancien et le nouveau... | Photo : Marc Ribès |
La sacristie

Rajoutée peu après 1845 et la réouverture au culte, elle respecte le caractère sacré des lieux en ne jurant pas. Son mobilier comporte deux grandes armoires encastrées aux portes ornées de motifs trilobés et quadrilobés qui rappellent ceux de la chaire à prêcher. Entre elles se trouve le meuble à linge liturgique avec ses grands tiroirs plats destinés à la conservation des aubes, chasubles, nappes d’autel...
Photo : Jean-Claude Quevilly.
On y trouve également deux petits meubles fermés par cadenas, probablement utilisés pour entreposer le vin de messe et objets liturgiques sensibles. Ou temporairement, la quête, en attendant que le bedeau la transfère vers un lieu plus sûr ou la remette au curé, autrefois résident à Jumièges, qu’il rejoignait dans sa 4CV noire corbeau. Quand elle ne tombait pas en panne...
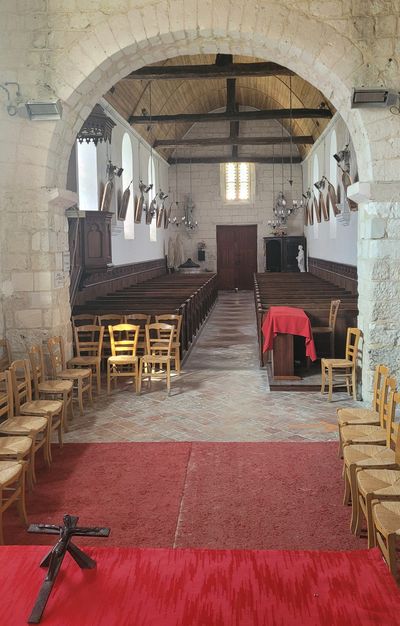 |
◄Photo prise de l'autel vers la sortie. ▼Le tronc est à gauche en sortant (Photos:Marc
Ribès
)  |
Voilà mes mes biens chères sœurs, biens chers frères, la visite est terminée. Et surtout n'oubliez pas le guide...
SOURCES
Répertoire archéologique de la Seine-Inférieur, abbé Cochet, 1871.
Géographie de la Seine-Inférieure, abbés Bunel et Tougard, 1879.La peinture décorative en France; du XIe au XVIe s., édition de 1879 avec planches en couleur, Pierre Gélis-Didot.
Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-Inférieure. Volume 21 - Page 108
Liliane Vian-Lacaisse
Délibérations du conseil municipal d'Yainville numérisées par Edith Lebourgeois.
Haut de page












