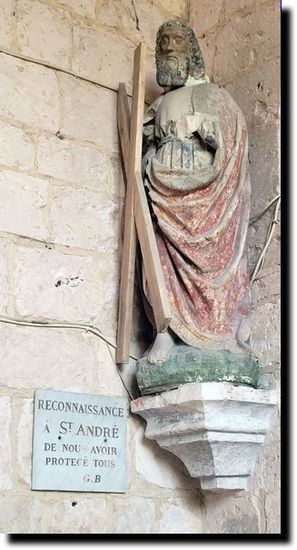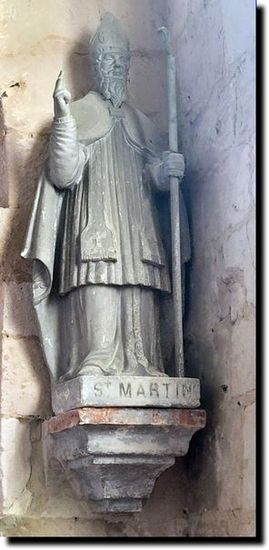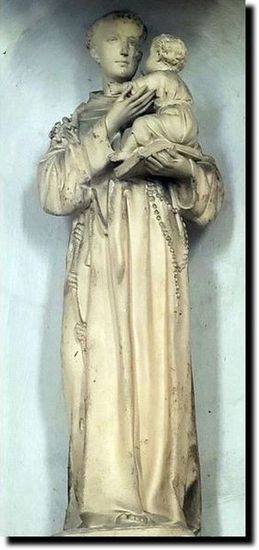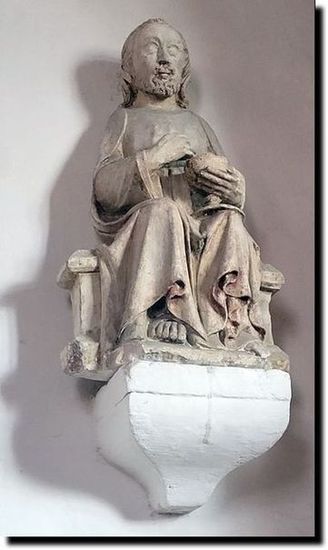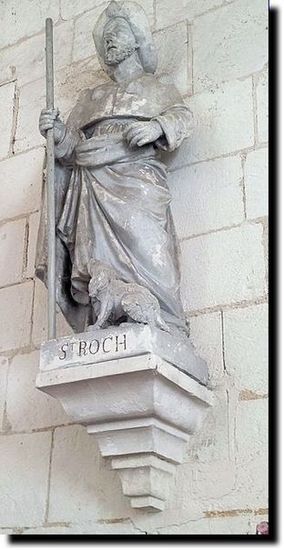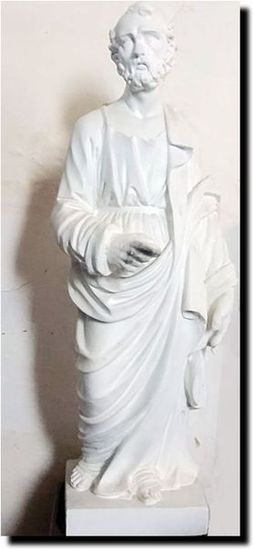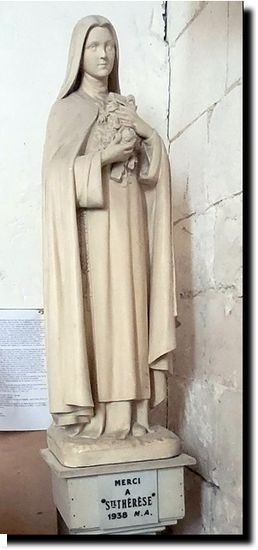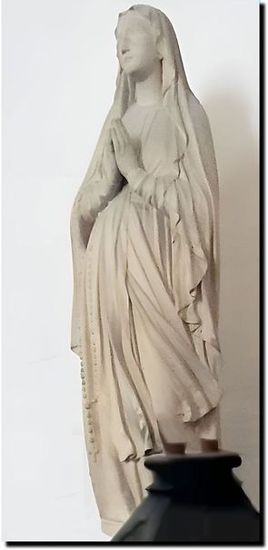Par
Laurent Quevilly-Mainberte
Photos : Marc Ribès
 Jamais le mot
fidèles n'a été autant
justifié en religion. Après un
demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville
retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix
personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...
Jamais le mot
fidèles n'a été autant
justifié en religion. Après un
demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville
retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix
personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...
Il faisait sûrement beau, le dimanche 22 juillet 1846. En tout cas dans le cœur des Yainvillais. Ce jour-là, Mgr Louis Brancard de Bailleul, archevêque de Rouen, vint bénir l'église Saint-André. Bancs, vitraux, fonts baptismaux, confessionnal, chemin de croix... Après un demi-siècle d'abandon, il fallut la remeubler entièrement. Les statues n'apparaissent pas dans les inventaires de l'ancien régime et post-révolutionnaires que nous avons pu consulter. En revanche, elles figurent bien sur les premières plaques de verres prises à l'intérieur de l'église.
Un constat : Ces statues ont la bougeotte mises à part deux : saint André et saint Martin, arc boutés au pilier de la travée sous clocher, juste avant l'abside. Les autres ont souvent changé de place. Pour ne pas dire de fonction. Allant de l'autel aux fonts baptismaux ou se postant près du confessionnal. Ce qui montre que ce patrimoine n'est pas figé et évolue au gré de la volonté des paroissiens. Arrêt sur image en 2025...
La présence d'un Jésus si ancien et du vieux saint André donne un lustre particulier à la collection yainvillaise. Si toutefois elles sont ici d’origine, ces sculptures, plutôt réservées aux édifices de plus grande envergure, témoignent davantage du rayonnement passé des moines de Jumièges que de l’importance de notre modeste paroisse
Ces statues donnent en tout cas une représentation équilibrée des figures chrétiennes : apôtres et évêques, saint guérisseurs ou protecteurs, présence féminine importante dans la piété populaire.
Du XIIIe au gothique tardif, de la pierre au plâtre, ces quelques statues donnent aussi dans un espace restreint et avec une économie de moyens, un bel aperçu de l'évolution de l'art chrétien. Elles méritent d’être protégées, connues, vues. Prenez le temps d’observer les visages, les gestes, les vêtements. Chaque détail raconte une histoire.
Photos : Marc Ribès
 Jamais le mot
fidèles n'a été autant
justifié en religion. Après un
demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville
retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix
personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...
Jamais le mot
fidèles n'a été autant
justifié en religion. Après un
demi-siècle d'abandon, l'église d'Yainville
retrouva les siens en 1846. S'ils sont moins nombreux aujourd'hui, dix
personnages s'y dressent en permanence, de jour comme de nuit...Il faisait sûrement beau, le dimanche 22 juillet 1846. En tout cas dans le cœur des Yainvillais. Ce jour-là, Mgr Louis Brancard de Bailleul, archevêque de Rouen, vint bénir l'église Saint-André. Bancs, vitraux, fonts baptismaux, confessionnal, chemin de croix... Après un demi-siècle d'abandon, il fallut la remeubler entièrement. Les statues n'apparaissent pas dans les inventaires de l'ancien régime et post-révolutionnaires que nous avons pu consulter. En revanche, elles figurent bien sur les premières plaques de verres prises à l'intérieur de l'église.
Un constat : Ces statues ont la bougeotte mises à part deux : saint André et saint Martin, arc boutés au pilier de la travée sous clocher, juste avant l'abside. Les autres ont souvent changé de place. Pour ne pas dire de fonction. Allant de l'autel aux fonts baptismaux ou se postant près du confessionnal. Ce qui montre que ce patrimoine n'est pas figé et évolue au gré de la volonté des paroissiens. Arrêt sur image en 2025...
|
|||||
|
|
|||||
| Certains
ont cru reconnaître saint
Jacques le Majeur dans ce Pèlerin. Mais il s'agit bien de
Saint-Roch en raison du chien représenté
à ses pieds. Lorsqu’il contracta la peste et
s’isola dans une forêt, le chien d’un
noble voisin, nous dit la tradition
chrétienne, vint chaque jour lui apporter du pain
volé sur la table de son maître.
Grâce à lui, Roch survécut. Il est
symbole de fidélité, de secours
providentiel, voire de charité animale
C’est un
pont entre le monde
humain et le monde de la création, thème
cher à la spiritualité
médiévale.
Dans les campagnes, l'image du pestiféré secouru
par un animal touchait
profondément. Roch
est invoqué contre les maladies. Près du confessionnal, Joseph tend une oreille discrète. Ce qui lui sied à merveille. Son attitude humble, sans attributs apparents, rappelle le protecteur de la Sainte Famille, un modèle d’écoute. |
|||||
|
|
|||||
|
Portant des roses,
emblème de son amour
du Christ, Thérèse de Lisieux est
vénérée pour sa simplicité
et son intercession, par
quelques plaques votives à son nom. Enfin Marie, après avoir siégé avec Madeleine près de l'autel, prie silencieusement et symbolise la pureté près des fonts baptismaux qui marquent l'entrée dans la vie chrétienne. |
|||||
La présence d'un Jésus si ancien et du vieux saint André donne un lustre particulier à la collection yainvillaise. Si toutefois elles sont ici d’origine, ces sculptures, plutôt réservées aux édifices de plus grande envergure, témoignent davantage du rayonnement passé des moines de Jumièges que de l’importance de notre modeste paroisse
Ces statues donnent en tout cas une représentation équilibrée des figures chrétiennes : apôtres et évêques, saint guérisseurs ou protecteurs, présence féminine importante dans la piété populaire.
Du XIIIe au gothique tardif, de la pierre au plâtre, ces quelques statues donnent aussi dans un espace restreint et avec une économie de moyens, un bel aperçu de l'évolution de l'art chrétien. Elles méritent d’être protégées, connues, vues. Prenez le temps d’observer les visages, les gestes, les vêtements. Chaque détail raconte une histoire.
Laurent QUEVILLY.
Sur des photos de Marc Ribès
Sur des photos de Marc Ribès