Par Laurent Quevilly-Mainberte
 Imaginez
Yainville sans son clocher. Et ce n'est plus Yainville !
C’est ce qui allait arriver quand, en
1840, la
fabrique de
Jumièges approuva cette hérésie :
Imaginez
Yainville sans son clocher. Et ce n'est plus Yainville !
C’est ce qui allait arriver quand, en
1840, la
fabrique de
Jumièges approuva cette hérésie :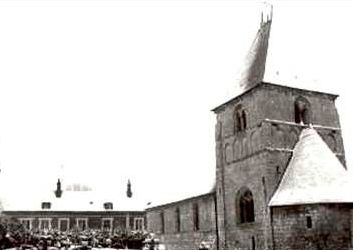 Entendez-vous le
tintement de la cloche de Yainville, un
dimanche matin d'hiver, quand le soleil éblouit la
gelée blanche et que la
neige anoblit toutes choses... S'il est un monument qui me tient
à cœur, c'est
bien l'église Saint-André. C'est là
que reposent mes devanciers. J'y
ai été
l'enfant de chœur d'un saint homme et je puis vous affirmer,
sans risque d'être démenti par les archives du
Vatican, qu'aucun
prêtre n'aura jamais connu servant si
maladroit.
Entendez-vous le
tintement de la cloche de Yainville, un
dimanche matin d'hiver, quand le soleil éblouit la
gelée blanche et que la
neige anoblit toutes choses... S'il est un monument qui me tient
à cœur, c'est
bien l'église Saint-André. C'est là
que reposent mes devanciers. J'y
ai été
l'enfant de chœur d'un saint homme et je puis vous affirmer,
sans risque d'être démenti par les archives du
Vatican, qu'aucun
prêtre n'aura jamais connu servant si
maladroit.
L'église de ma jeunesse avait une fonction sociale de toute première importance. C'était encore le seul lieu où se retrouvaient chaque semaine un si grand nombre de Yainvillais dans leur "comestume" du dimanche.
C'est l'église de Yainville qui m'a fait aimer les vieilles pierres. Elle était notre château féodal, la mémoire du village. Combien de fois ai-je essayé de déchiffrer les inscriptions de tombes moussues et tout de guingois. Combien de fois suis-je allé coller mon nez contre le carreau des deux petites chapelles funéraires. Celle de la famille Boulanger qui passait pour avoir été les châtelains d'Yainville avant Sacha Guitry. Celle d'Émile Silvestre, l'ancien carrier de Claquevent et maire d'Yainville dont le portrait, sur une plaque de verre, semblait nous dévisager à travers la pénombre. Lui, le si bon Chrétien à qui mon grand-père devait un mois de prison pour une histoire de bout de ficelle...
Au commencement...| Sans
doute un simple oratoire est-il à l'origine de
l'église Saint-André. Il fut dressé
près de
la seule
entrée percée dans l'immense talus
défensif qui, jadis,
barrait
l'entrée de la presqu'île. Aussi n'est pas
définitivement exclu que ce sanctuaire ait eu d'abord une
fonction
militaire puis religieuse à ses origines, voire un
mélange des deux. Après tout, le cas de figure se
rencontre ailleurs. Mais va pour une église primitive. Comme l'abbaye de Jumièges, le temple yainvillais, s'il existait déjà, aura été ravagé par les vikings. Et sans doute abandonné en 845. Guillaume Longue Épée, le 20 février 930, restitua le lieu à l'abbaye de Jumièges. On dut alors élever sur des ruines un nouveau sanctuaire en pierres de Caumont. |
Saint André...
Son patronage s'est développé au Moyen Âge, souvent dans la mouvance d'une abbaye comme à Yainville et au Bec-Hellouin dont les églises sont du XIe s. André était invoqué contre les orages, pour protéger les récoltes. Une dizaine d'églises portent son nom en Haute-Normandie. Sans compter chapelles et vitraux. Rouen a compté une église de Saint-André-de-la-Ville où mes ancêtre directs, Pierre Quevilly "de Ducler" et Colette Trubert, se sont mariés en 1633 sous Louis XIII. Elle a été rasée en 1861. |
L'assassinat du duc de Normandie, en 942, suspendit les travaux. L'an 1027, Robert le Magnifique, Ier duc de Normandie ordonna l'achèvement du chantier sous la forme globale où nous apparaît l'église aujourd'hui. Des fouilles archéologiques en diraient plus sur l'historique avancé ici. Mais les premiers fidèles en tout cas n'étaient pas encore Français. Mais bien Normands. C'étaient les sujets d'un duc disposant d'une indépendance de fait malgré sa vassalité envers le roi Robert II.
Le clocher Le
clocher de Yainville, "grosse tour
carrée des plus primitives"
nous dit
l'abbé Cochet, est assis entre la
nef et l'abside, épaulé par de puissants
contreforts. Réalisé avec un savoir-faire
avancé,
il s'inspire des tours de
Jumièges. Lui-même a servi de modèle
à celui de Bliquetuit, quelque
deux siècles plus tard. Et l'on voudrait que
l'église de
New-Haven l'ait pris pour modèle. Nous verrons ce qu'il en
est
vraiment...
Le
clocher de Yainville, "grosse tour
carrée des plus primitives"
nous dit
l'abbé Cochet, est assis entre la
nef et l'abside, épaulé par de puissants
contreforts. Réalisé avec un savoir-faire
avancé,
il s'inspire des tours de
Jumièges. Lui-même a servi de modèle
à celui de Bliquetuit, quelque
deux siècles plus tard. Et l'on voudrait que
l'église de
New-Haven l'ait pris pour modèle. Nous verrons ce qu'il en
est
vraiment...
La base
de notre clocher est une haute souche simplement raidie par des
contreforts d'angles. Ellle es percée d'une baie au sud et
doté d'une sacristie au nord.
| Cette architecture me rappelait Jumièges et l'âme naïve que j'étais ne comprenait pas pourquoi nos devanciers s'étaient ainsi calfeutrés. Sans doute les bâtisseurs avaient-ils été dérangés dans leur travail par le Diable en personne ! |
 |
En réalité, ces arcatures aveugles relèvent, paraît-il, d'un style décoratif courant, rythmant et allégeant l'aspect général du clocher en faisant la transition entre un rez-de-chaussée fermé et l'étage campanaire ouvert à tous vents. Un style inspiré de l’architecture lombarde et notamment diffusé par les Bénédictins de Cluny.
Notons que dans son numéro de janvier 1933, le Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure dira : "M. Lanfry, de la part de M. Auvray, annonce qu'un crédit pour la restauration de l'église d'Yainville-sous-Jumièges a permis de restituer les pierres apparentes et l'emplacement des baies fermées au XVIe siècle dans le clocher." De quelles baies parle-t-on ? Mystère. Sur les gravures du début XIXe, elles sont toutes ouvertes...
 Le
présente sur
trois faces un grand arc en plein-cintre encadrant deux
étroites baies géminées
séparées par une colonnette.
Côté nord, cette dernière est
curieusement
spiralée. Certain y ont vu une inspiration
pré romane.
D'autres une modification plus récente permettant
d'améliorer l'acoustique de la cloche et de la
protéger des
intempéries.
Le
présente sur
trois faces un grand arc en plein-cintre encadrant deux
étroites baies géminées
séparées par une colonnette.
Côté nord, cette dernière est
curieusement
spiralée. Certain y ont vu une inspiration
pré romane.
D'autres une modification plus récente permettant
d'améliorer l'acoustique de la cloche et de la
protéger des
intempéries.
Des cloches, Yainville en comptait
deux en 1789. Aujourd'hui, une seule suffit. Lire notre page spéciale :
Beaucoup plus sobre est la quatrième ouverture, à l'arrière du clocher, de forme rectangulaire.
 Enfin,
sous la haute toiture
en hache, typique des régions à forte
pluviométrie, court une corniche à modillons que
je
comparais
aux créneaux d'une
forteresse. Plus prosaïquement, il s'agit d'un dispositif
d'évacuation des eaux pluviales. Le tout est
couronné
d'un coq que perdra quelques plumes, comme
vous le
verrez, au cours de l'histoire. En attendant, bien campé sur
sa
girouette, il
symbolise
avec superbe vigilance et résurrection. Il a fait l'objet de
plusieurs restaurations, notamment en 1987 et 2023. Il regagna alors
son perchoir après sa toilette à
Sainte-Austreberthe, aux
ateliers Biard-Roy et fut béni par l'abbé
Thumaini.
Enfin,
sous la haute toiture
en hache, typique des régions à forte
pluviométrie, court une corniche à modillons que
je
comparais
aux créneaux d'une
forteresse. Plus prosaïquement, il s'agit d'un dispositif
d'évacuation des eaux pluviales. Le tout est
couronné
d'un coq que perdra quelques plumes, comme
vous le
verrez, au cours de l'histoire. En attendant, bien campé sur
sa
girouette, il
symbolise
avec superbe vigilance et résurrection. Il a fait l'objet de
plusieurs restaurations, notamment en 1987 et 2023. Il regagna alors
son perchoir après sa toilette à
Sainte-Austreberthe, aux
ateliers Biard-Roy et fut béni par l'abbé
Thumaini.
 |
||
|
La façade ouest
C'est celle du portail d'entrée avec son arc semi-circulaire fait de sobres voussures. Je me souviens de ces enterrements où les Communistes de la centrale, alors nombreux, se tenaient obstinément à l'extérieur du porche pour assister à la cérémonie.
Ce narthex est encadré par une demi-douzaine de graffiti plus ou moins lisibles. Sauf deux qui nous paraissaient insolites. Ils représentaient grossièrement des voiliers. J'ignorais encore que mes ancêtres, comme Jehan de Mainberte, avaient compté parmi les tout premiers Terre-Neuvas au XVIe siècle. Mais ces dessins leur étaient même antérieurs. On nous dit du XIVe ou XVe siècle. Ils nous ramènent au temps où Port-Jumièges comptait un chantier naval et sans doute aussi Yainville.

Graffiti d'une navire fluvial localisé sur le mur occidental. (Photo : Fondation de France, campagne 2022 pour la restauration de l'église d'Yainville.)
Au dessus du portail se voit une fenêtre à meneaux. Elle est dotée de deux vitraux décoratifs avec des motifs en losanges. Ce type d'ouverture n'est pas typique de l'art roman primitif. Son rajout et ses vitraux d'une facture économique servent simplement à éclairer l’arrière de la nef et à réhausser l'entrée d'une certaine dignité, sans excès ornemental.
La façade nord
Bien que l'entrée d'une église se situe rarement au nord, symboliquement considéré comme "le côté de l'ombre", l'église d'Yainville en a compté deux, aujourd'hui condamnées. L'une simplement de l'intérieur de l'église. L'autre totalement.
La restauration de 2025 a rendu bien visible l'ancienne porte latérale. (Photo : Hubert Vézier / cliquer pour agrandir).
La relève entre ces deux entrées latérales de l'église se serait opérée aux XVIe siècle à l'occasion du profond remaniement connu par Saint-André. Les trois baies visibles à présent ont été ouvertes lors des travaux entamés en 1844 pour la réouverture au culte de l'église et ornées de vitraux aux motifs géométriques. Du coup, des traces de deux anciennes baies sont encore lisibles dans la pierre de cette façade. Notamment une meurtrière. Ainsi notre sanctuaire se sera-t-il adapté au fil des siècles pour des raisons liturgiques, défensives, climatiques ou simplement pratiques, liées à l'évolution intérieure de l'église. Près du portail se voit un seul graffiti.
Enfin c'est sur cette façade, au pied du clocher, qu'a été rajoutée une sacristie en 1850. Elle respecte l'architecture originale.
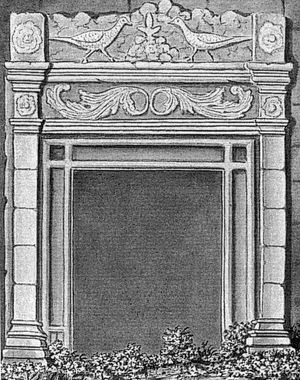 |
 |
C'est celle où se situe l'abside semi
circulaire. Le
chœur de l'église est en effet contenu dans une
structure en cul du four datant des
XIe et XIIe siècles.
Le clocher présente des rangées de quatre arcatures aveugles côté nord et côté sud. Aucune à l'ouest. Mais cinq côté est. Or, le toit de l'abside masque l'arcature centrale. L'abside aurait donc été rajoutée à une tour défensive primitive où une petite église plus petite. A moins que la toiture de l'abside ait été réhaussée après sa construction.
Fondation du Patrimoine
Un contrefort central, très plat, est percé d'une fenêtre. Ce qui ne se voit qu'à Ecajeul, Fiquefleur ou encore Rocqueville. Le contrefort est, par définition, un élément de renfort destiné à contrebuter la poussée des voûtes ou de la toiture.
 Percer un contrefort affaiblit potentiellement sa
fonction
structurelle. c’est à cet endroit que les efforts
de
poussée convergent, donc théoriquement
l’un des
points les plus sollicités. Mais ici, la dimension modeste
de
l'abside minimise la fragilisation de la structure. La
maçonnerie est massive, l'ouverture étroite.
Percer un contrefort affaiblit potentiellement sa
fonction
structurelle. c’est à cet endroit que les efforts
de
poussée convergent, donc théoriquement
l’un des
points les plus sollicités. Mais ici, la dimension modeste
de
l'abside minimise la fragilisation de la structure. La
maçonnerie est massive, l'ouverture étroite.
Sur ce contrefort est
gravé un graffiti. Comme à
Saint-Valentin, de Jumièges,
les trois fenêtres du chœur, étroites
vues de l'extérieur, sont de larges
rectangles à l'intérieur.
J'ai
encore dans l'oreille le crissement des pas sur le gravier quand je
contournais l'abside par l'étroit sentier qui me menait
à la tombe de ma mère. Allons-y...
La façade sud
Elle aussi a été profondément remaniée. D'abord au XVIe siècle avec l'ouverture d'un fenestrage gothique flamboyant de 2,30 m de large, style reconnaissable à son arc brisé et son remplage ornemental. L’ajout d’une grande baie peut correspondre à un besoin d’éclairage accru à une époque où la liturgie évolue. Le siècle est marqué par une importance croissante du chœur, la mise en valeur des autels, l'introduction de la musique. Dans les années 1830, la baie était en piteux état. Il lui manquait la moitié de ses meneaux qui seront reconstitués en 1845.
Lors de la
réstauration de 2025, l'ancienne baie gothique de la nef a
été remise en valeur pour rappeler l'histoire de
l'église (Photo Marc Ribès / cliquer
pour voir
l'église dans son environnement)
Comme la façade nord, la sud aura droit à ses trois nouvelles baies néo-romanes lors de la grande restauration du XIXe. Du coup, ce mur garde aussi les cicatrices des anciennes ouvertures. Proche du clocher, l'une des bais qui fut obstruée était à l'origine de forme ogivale avec un arc supérieur orné d’un motif en courbe inversée.
Sous la baie gothique se voit une percée rectangulaire donnant sur le chœur et qui fut peut-être rouverte lors de la remise en service de l'église. A cette époque, de la terre fut déblayée au pied de ce mur pour neutraliser les infiltrations si bien que le cimetière se trouve a un niveau supérieur que le pourtour de l'édifice.
C'est de ce côté de l'église que reposent mes parents, mes grands-parents maternels, Émile Mainberte et Julia Chéron. Mais aussi des êtres chers comme ma tante Hjoerdis et sa mère Marie. Il y avait dans cette partie du cimetière un carré réservé aux enfants. Une sorte de solidarité teintée de compassion nous poussait parfois vers ces sépultures blanches où les noms nous étaient pourtant inconnus. Il se disait que dormaient là des anges...
Le décor est plantéVoilà, nous avons bouclé le tour de notre belle église. Jamais, nous ne nous serions douté qu'elle servit de grange à la Révolution. Abandonnée cinquante ans, il aura fallu la volonté du premier maire d'Yainville, l'entêtement des habitants, l'intérêt des savants et l'oreille compréhensive de l'Administration pour qu'elle soit sauvée in extremis. On édifia alors la sacristie. Mais je parle, je parle et quelqu'un vient d'ouvrir le portail. On y va ?
|
Vite
entrons |
 |





