Par
Laurent Quevilly-Mainberte
|
|
|
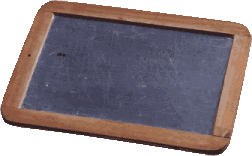 |
Sous
l’Ancien Régime, l’éducation était
bien balbutiante dans notre diocèse. En 1715,
l’évêque d’Aubigné constatait
que 18 paroisses, dont Yainville, n’avaient aucune
école. Curés, vicaires, clercs ou simples particuliers
assuraient parfois un enseignement empirique
Et
dire qu'en 1795, Yainville aurait pu devenir le chef-lieu d’un
arrondissement scolaire. C'était le souhait des instances
révolutionnaires. Mais la municipalité refuse, arguant
qu'il pleut dans le presbytère. A quoi tiennent les grandes
occasions ratées. Alors, Yainville propose de céder
la place à la commune voisine du Trait. Elle, son
presbytère s'y prête et peut loger l'instituteur. On juge
même sa position centrale, y compris pour les enfants de
Jumièges. Ce qui témoigne d'un besoin urgent en
cours de calcul et de géographie...
Les autorités d’Yvetot acceptent ce transfert,
appuyées par les pétitions convergentes des deux
villages. Le 10 juin 1795, le Trait devient officiellement le
siège de l’école. On y affecte donc un instituteur,
Étienne Loiselier, originaire des Vieux. Flatté, celui-ci
refuse aussitôt pour raisons personnelles.
Faute de remplaçant, l’ouverture de l’école
marque le pas. L’Administration s’agace. Pendant ce
temps, Pierre Harel, vieil instituteur déjà en poste au
Trait depuis trois ans, profite de ce moment de flottement pour
défendre son pré carré. Soutenu par les habitants
et les autorités locales, il finit par être
confirmé comme enseignant.
Mais les autorités supérieurs n'en démordent pas. En
1796, Jacques-François Lecomte, instituteur à Duclair,
est à son tour bombardé d’office au Trait. Il proteste avec
véhémence, dénonçant une manœuvre
politique pour l'éloigner de Duclair au profit de Jean Delanos,
curé défroqué. Lecomte fait jouer sa situation de
père
de famille, critique les compétences de ses rivaux et
réclame le cas échéant un autre poste que Le
Trait, pourquoi pas Jumièges, alors
vacant. Rien n'y fait. S'en suit un échange nourri de fautes
d'orthographes entre l'enseignant et l’Administration cantonale
qui le juge médiocre, tout juste bon à enseigner les
bases.
En
mars 1798, un instituteur de Rouen vint se mêler de la partie en
sollicitant un poste dans le canton. Il soigna sa lettre de motivation :
Aux citoyens administrateurs composant l'administration municipale du canton de Duclair,
Supplie
humblement, Charles Guillaume Gentais, désirant s'établir
dans l'arrondissement du canton de Duclair en qualité
d'instituteur pour y enseigner à lire, écrite,
l'arithmétique, le tout suivant les lois constitutionnelles de
la République, ce pourquoi, citoyens, il réclame votre
autorité à fin de lui procurer une commune dans laquelle
il puisse exercer librement comme celle de Yainville si toute fois il
n'y en a pas d'autres de vacantes pour l'instant.
Celle de Yainville ! Désolé, mais Yainville n'a pas d'école. Du coup, après passage devant un jury d'instruction à Yvetot, Gentais fut affecté... à Jumièges !
Pendant ce ce temps, cette même année 1798, c’est un autre curé défroqué, Le Painteur, qui officie désormais comme instituteur au Trait. Mais lui aussi se plaint : on ne le paie qu’en pain, et encore, pas toujours… Sur sa vingtaine d'élèves, seuls deux grimpent la côte Béchère, frôlés de trop près par les voitures publiques : Pascal-François Foloppe, fils d'un employé des fermes du Roi et Ferdinand Capelle. Tenons-les pour doyens de l'amicale des anciens élèves yainvillais.
Tiraillée entre Le Trait et Jumièges...Ainsi donc, l'instruction n'étant pas encore obligatoire et gratuite, les quelques Yainvillais qui tenaient à scolariser leurs enfants pouvaient se tourner vers le Trait. D'ailleurs, en 1835, la commune fut invitée à s'unir avec sa voisines sur le plan scolaire. Ce qui ne semble guère avoir été suivi d'effet. Car quelques années plus tard, on trouve de petits Yainvillais scolariés à Jumièges. Et Jumièges, ayant déjà phagocyté Yainville sur le plan religieux, n'attendait plus qu'une occasion pour la digérer sur le plan civil. L'école fournit à nos voisins l'occasion rêvée de nous chercher des poux. Ou plutôt de nous demander des sous. Le nerf de la guerre. Et Yainville ne pouvait s'y soustraire.
Cet épisode décisif y lieu à la fin de 1851. Le conseil municipal de Jumièges adopta le vœu "que la commune de Yainville, dont les enfants fréquentent l'école Jumièges, soit astreinte à payer à l'instituteur pour l'instruction des indigents." L'instituteur en question, c'était Nicolas Maillon qui venait d'inaugurer la mairie toute neuve bâtie sur la place de Jumièges. Un gros investissement...
Pour le préfet, Yainville ne pouvait rester sourd à l'injonction des Jumiégeois. La Loi plaidait pour eux. A moins, à moins de bâtir ou contribuer financièrement à l'entretien d'une école déjà existante où seraient scolarisés ses enfants pauvres. Il y avait bientôt 20 ans que la loi Guizot mettait chaque commune dans l'obligation d'entretenir une école ou, à défaut, de s'unir avec une voisine. Yainville qui s'était fortement endettée pour rouvrir son église était donc à la ramasse. Alors, on regarda encore vers le Trait. Et encore vers Jumièges. Trop loin, trop dangereux pour nos enfants estimèrent les élus yainvillais. Sur un coin de table, ils griffonnèrent un montage financier, ils lurent et relurent cette loi qui leur permettrait, faute de finances suffisantes, d'obtenir des aides. Et leur décision fut prise.
L'école enfin créé !Quand vint février 1852, un circulaire préfectorale vint accélérer le processus. On demandait à Yainville d'adresser le prévisionnel des dépenses scolaires prévues pour l'année suivante. Lafosse prit un malin plaisir à rappeler au représentant de l'État que son conseil était dispensé de délibérer sur la question. Puisqu'il n'y avait toujours pas d'école, toujours pas d'instituteur à Yainville. Le Préfet prit aussitôt le taureau par les cornes. Il autorisa enfin cette création. On retriendra donc 1852 comme une date hidtorique. Encore fallait--il trouver un instituteur. Et surout une "maison d'école"...
Le premier lieu qui nous soit connu appartient à Jean Isidore Aubé, l'adjoint au maire. Natif de Jumièges, cultivateur et fermier, il vit non loin de l'église en compagnie de Caroline Andrieux, Havraise de naissance. Ils ont deux filles en bas-âge ainsi qu'un jeune domestique.
Langlois, premier instituteur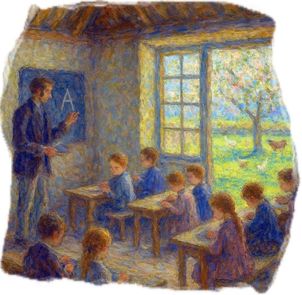 Nommé le 15 novembre 1852, ce
fut Pierre
Constant Langlois, 20 ans qui fut notre tout premier enseignant Fils et
frère d'instituteurs, neveu d'un capitaine au long cours, il est
né le 5 février 1831 à Bliquetuit. $
Nommé le 15 novembre 1852, ce
fut Pierre
Constant Langlois, 20 ans qui fut notre tout premier enseignant Fils et
frère d'instituteurs, neveu d'un capitaine au long cours, il est
né le 5 février 1831 à Bliquetuit. $A comme abeille...
Trente
élèves composaient en théorie sa classe unique
à géométrie variable. En ces années 1850,
les calendriers scolaires n’étaient pas uniformes
d’une commune à l’autre. Leurs colonnes restaient
fortement influencées par les besoins agricoles et les
traditions locales, avec des rentrées souvent en
octobre-novembre pour finir en juillet-août.
On
est donc encore loin de la semaine des quatre jeudis et les petits
Yainvillais vont théoriquement en classe du lundi au samedi inclus selon des horaires
élastiques et personnalisés en fonction des besoins.
Alors, quand trouvent-il le temps d'aller au caté, le dimanche
après-midi ? P'têt ben qu'oui. Mais p'tête ben
qu'non. Avec la morale et l'instruction civique, l'éducation
religieuse figurait au programme, voire avec le concours du
curé dans la classe.
 Tenez, justement le
voici ! Langlois fut installé officiellement le 16 novembre
1852 en présence du maire, des conseillers, mais aussi... de
l'abbé Houlière, fameux
chansonnier normand et locataire du presbytère vétuste
d'Yainville :
Tenez, justement le
voici ! Langlois fut installé officiellement le 16 novembre
1852 en présence du maire, des conseillers, mais aussi... de
l'abbé Houlière, fameux
chansonnier normand et locataire du presbytère vétuste
d'Yainville :"Nous, maire de la commune d'Yainville, nous sommes transportés en la maison d'école de la dite commune et, vu la lettre de Monsieur le recteur de l'académie en date du 4 courant qui nomme le sieur Langlois Pierre Constant instituteur communal d'Yainville, en vertu de la délégation à nous délivrée par Monsieur le Recteur en date du 15 courant, avons, en présence des membres du conseil municipal soussignés et de Monsieur le desservant aussi soussigné procédé à l'installation du sieur Langlois Pierre Constant instituteur de notre commune..."
Avec la République, l’enseignement primaire ambitionnait de transmettre des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, arithmétique) tout en promouvant des valeurs démocratiques. Cependant, ces ambitions étaient freinées par l’influence de l’Église, renforcée par la loi Falloux de 1850, qui imposait l’instruction religieuse. À Yainville, commune rurale, l’école communale se concentrait sur ces savoirs de base, avec une forte influence de la paroisse nouvellement reconstituée sous la présidence du châtelain du Taillis.
Mais cette Seconde République est déjà morte. Le 5 décembre, Langlois participe à sa première cérémonie populaire sur la place publique du village qui réunit le conseil, les habitants, les fonctionnaires. Ce jour-là est lue la proclamation de Napoléon III :
Français
! Le peuple, consulté librement, a exprimé sa
volonté avec une force éclatante. Il a reconnu dans le
nom de Napoléon le symbole de la gloire nationale, de la
stabilité et de la grandeur.
Par la volonté souveraine de la Nation, le Second Empire est
proclamé, et Louis-Napoléon Bonaparte devient
Napoléon III, Empereur des Français. Vive
l’Empereur ! Vive la France !
Mais voilà que l'on tire grise mine à l'école d'Yainville. Présent encore à la cérémonie, Jean Isidore Aubé, l'adjoint, meurt subitement le 2 janvier 1853 à 37 ans. Mabon et Grain, amis et voisins, déclarent le décès au maire. Mabon qui, propriétaire et rentier, déjà conseiller municipal, va succéder à Aubé qui laisse une jeune veuve deux petites filles et un domestique dont on va se séparer. Caroline continuera à exploiter sa ferme. Seule. Jusqu'à la mort.
Mabon ? un sacré collègue !
Quels
seront les rapports de Langlois avec l'homme qui, là-bas, se tient près du maire ? François Pierre
Mabon, le notable que nous venons d'installer comme adjoint,
est un revenant. Natif de Bliquetuit, tiens, comme Langlois, il avait
été nommé en 1820 instituteur au Trait par le
maire de cette commune, Jacques-Joseph Tiphagne. Aussitôt, le
Recteur d'académie ordonne une enquête auprès du
juge de Paix de Duclair. Elle fut défavorable. Mabon est
né, dit le magistrat, "dans une contrée de ce monde gangrenée de tous temps du plus redoutable libéralisme." Et
d'ajouter que pendant les Cent-Jours, un dénommé Mabon
avait persécuté le curé du Trait. En
réalité, c'était son frère...
Mabon s'est marié en 1824 à Yainville avec une
Delépine, famille au sang chaud. En 1826, il met fin à
ses fonctions d'instituteur,
date à laquelle il devint conseiller municipal du Trait. Il aura
pour successeur... un garçon de 17 ans, Leroy, ce qui mettra le
maire en rage. Mais bon, il n'avait qu'une demi-douzaine
d'élèves... Conseiller au Trait. Mabon appartenait
à une équipe qui rêvaint d'annexer sa voisine.
Mais bon, voilà Mabon établi ensuite à Yainville. Voisin de
Charles Lesain, au manoir de l'église, Mabon devint son adjoint
en 1839. Il fut de ceux qui s'opposèrent farouchement à
la restauration de l'église abandonnée depuis le Concordat. Il avait
pour cousin Jean-Louis Lafosse, gros contributeur de la commune qui,
lui, était favorable au projet.
Comme il l'avait été au Trait, Mabon,
sans complexe, fut partisan de l'absorption d'Yainville par
Jumièges dont il présida d'ailleurs la Fabrique en bon
chrétien. Animé d'un tel patriotisme, notre homme
démissionna de la mairie d'Yainville en 1846 en compagnie de
Lesain et Duval, tous trois désavoués par leurs
administrés et l'autorité préfectorale.
Et voila
que six ans après, à la faveur de la mort d'Aubé,
Mabon redevient adjoint. De Jean-Augustin Lafosse cette fois, son
ennemi d'hier.
Loisel, de passage...
Auguste Eléonore Loisel fut nommé par le Préfet le 25 août 1855. Né le 11 juillet 1828 à Hodeng-Hodenger, il a donc 27 ans et nous vient de l'école de Boissay, petit village du pays de Bray. Marié depuis deux ans, il est père de deux enfants,
On l'installa le 1er octobre suivant. L'abbé Houlière participa encore à la cérémonie présidée par Lafosse, maire, en compagnie de son conseil au grand complet dont Duval, ancien ennemi lui aussi, Pierre-Paul Grain, le propriétaire du presbytère, et puis le propre père du maire.
A peine intronisé, Loisel s'envola trois semaines plus tard vers un autre poste. On le retrouvera à Yvecrique. Père de huit enfants, il est décédé à Grémonville en 1901.
...Suivi d'un Beauvisage
Ce météorite fut officiellement remplacé le 1er octobre 1855 par Joseph François Beauvisage. Veuf d'Aglaë Painturier, il est né le 4 septembre 1826 à Monchy-sur-Eu. Les mêmes participants firent de nouveau tapisserie pour la cérémonie d'installation dans la salle ordinaire des débats.
Beauvisage poursuit l'œuvre de Langlois. L’histoire, intégrée à l’instruction morale, servira à construire un roman national glorifiant une France unie depuis le baptême de Clovis. Charlemagne, dépeint comme le fondateur de l'école, est appelé l'empereur à la barbe fleurie quand il se contentait de moustaches. Jeanne d’Arc, qui a son vitrail à l'église Saint-André, Jeanne d'Arc entend bien des voix divines et reconnaît Charles VII sans l'avoir jamais vu. Saint Louis est un roi pieux qui rend la justice sous un chêne suffisamment feuillu pour cacher sa politique antisémite et ses croisades sanglantes. le criminel de guerre Bayard est sans reproche, Henri IV instaure la « poule au pot » quand il est déjà mort, Surcouf est un intrépide corsaire et surtout pas négrier. Quant à Napoléon Ie, on le glorifie pour ses victoires et ses réformes. Le rétablissement de l'esclavage, le fiasco d'Haïti resteront sous le boisseau...
Ces récits biaisés, véhiculés par des manuels simplifiés et des instituteurs mal formés, reflétaient une volonté de forger une identité nationale au service du pouvoir impérial, au détriment d’une approche critique de l’Histoire. Quant au parler cauchois sur la cour, s'il ne subit pas une répression aussi féroce que le Breton, il va de plus en plus écorcher les oreilles des maîtres. De premières circulaires apparaissent pour lui faire la chasse dès 1856.
La commune
ayant le devoir de pourvoir au bon accueil des élèves et
au logement de l'instituteur, le 1er février 1856, on
s'inquiéta du renouvellement du bail de maison d'école,
sise chez la veuve Aubé et qui devait s'achever à la
Saint-Michel suivante. Le maire fut autorisé sans l'ombre d'une
discussion à en signer un nouveau de six ans.
En 1861, Beauvisage est localisé seul dans une maison du village
voisine de celle de Prosper Amour Houlière, un rentier.
Le bail
à la ferme Aubé arrivant a
expiration à la Saint-Michel de 1862, la classe trouva refuge la ferme du maire, Jean-Augustin Lafosse.
Gacouin, doublement fidèle
En février 1863, Victorien Stanislas Gacouin, nouvel instituteur, percevra 700 F de salaire.
Cet enseignant, né en 1835 d'un tisserand d'Harcanville, nous arrive la mine défaite de Cideville où il vient de perdre sa jeune femme, Henriette Levillain, après deux années de mariage. Veuvage de courte durée car sitôt arrivé il jure une seconde fois fidélité. le 18 mai suivant. Non plus à l'Empereur mais à une femme cette fois : Désirée Clarisse Bénard, venue de Valliquerville. C'est une proche de la défunte et elle aussi vient de perdre son conjoint.
Selon une enquête nationale de 1863‑64, notamment en Normandie, les inspecteurs soulignent que « la plupart des élèves, en arrivant à l’école, ne connaissent que le patois »
Lafosse, le maire, est toujours propriétaire du bâtiment qui accueille la mairie-école. Il perçoit pour cela un loyer. Mais les locaux sont jugés bien vétustes par l'Administration. Du coup, l'école déménage à la Saint-Michel de 1864 pour une maison appartenant à M. Caron.

Cette maison occupée par mon oncle, lle capitaine Chéron, fut un temps, assurati-il, la mairie école. Sa symétrie s'y prête mais l'information n'est pas confirmée L'école fut aussi localiséeg à l'angle des rues Pasteur et Jules-Ferry.
Si M. Gacouin nous a quittés en 1865, il n'ira pas bien loin. La mort le fauche le 31 octobre 1867 à Bertheauville. A 32 ans, il laissait derrière lui deux garçons dont Joseph, né à Yainville 20 mois plus tôt. Il sera plus tard cultivateur à Saint-Martin-aux-Arbres. Gacouin avait aussi sous son toit un garçon de 4 ans portant son nom, Auguste Gacouin ainsi qu'un pensionnaire de 13 ans, Henri Pontillon. Ce recensement est curieux. De sa première femme, décédée à 26 ans, Gacouin avait eu une fille, Rosalie Henriette qui se mariera plus tard à Cideville.
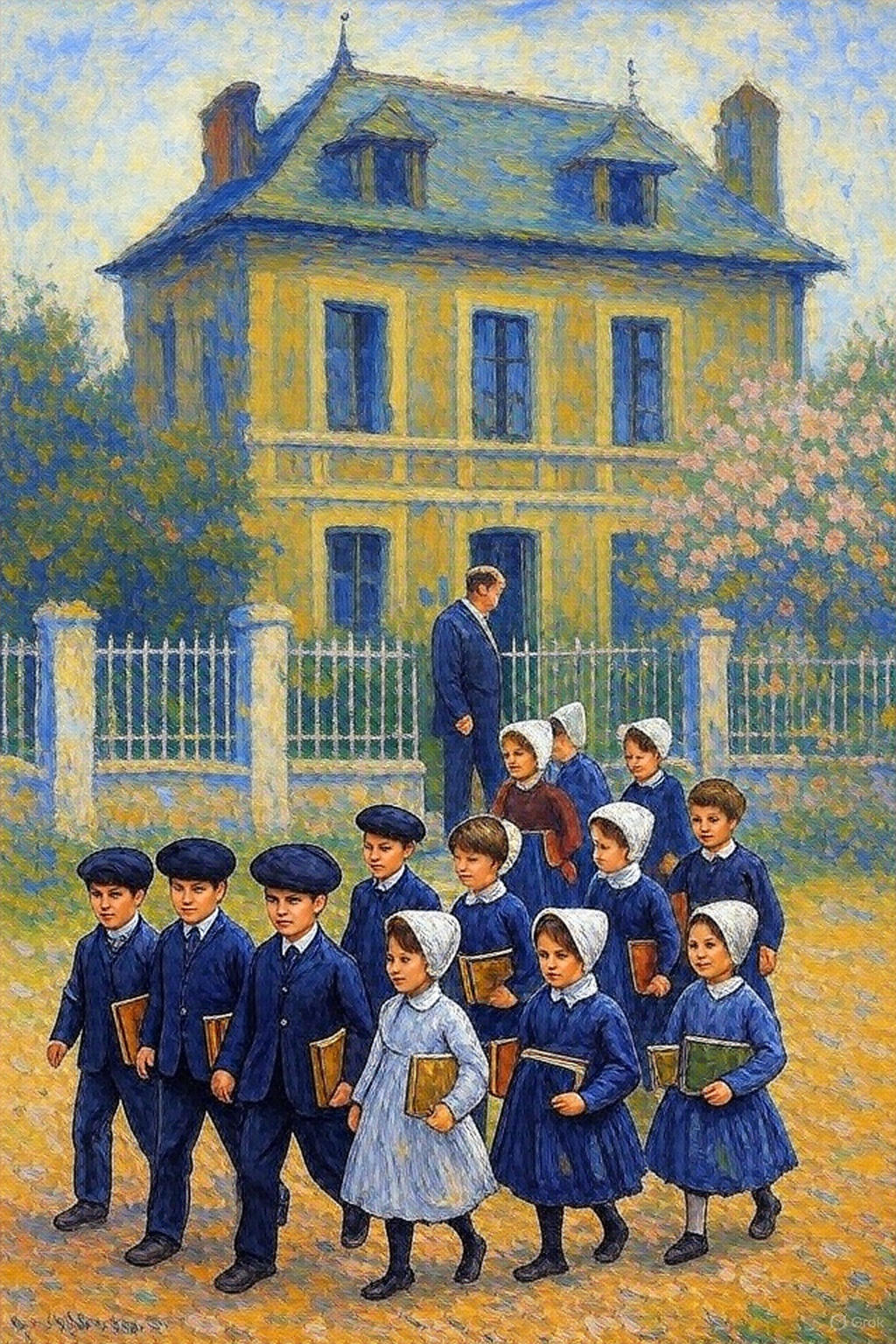 En 1873,
Edmond Blanchard succède à Breton. Il
a 45 ans. Edmond Alexandre Blanchard est né en 1829 à
Yvetot où il a épousé une fille du pays, Marie
Loisel. Le couple a une fille, Marie, et deux garçons :
Edmond et Gaston. Avant de venir jusqu'à nous, Blanchard a
enseigné à Villainville ou il est attesté en 1857
puis à Manéglise en 1859, Rouville en 1868.
En 1873,
Edmond Blanchard succède à Breton. Il
a 45 ans. Edmond Alexandre Blanchard est né en 1829 à
Yvetot où il a épousé une fille du pays, Marie
Loisel. Le couple a une fille, Marie, et deux garçons :
Edmond et Gaston. Avant de venir jusqu'à nous, Blanchard a
enseigné à Villainville ou il est attesté en 1857
puis à Manéglise en 1859, Rouville en 1868.
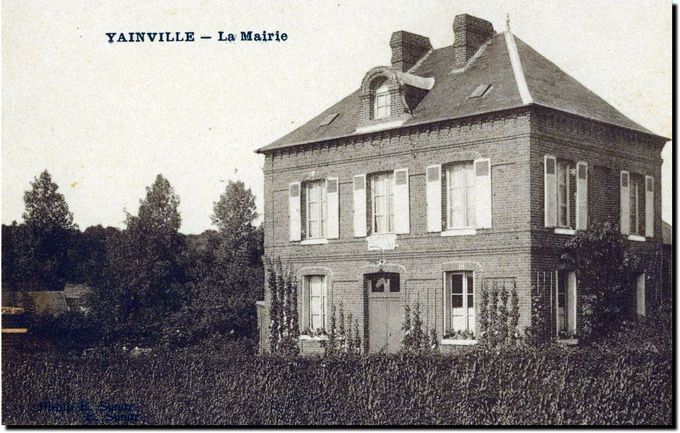
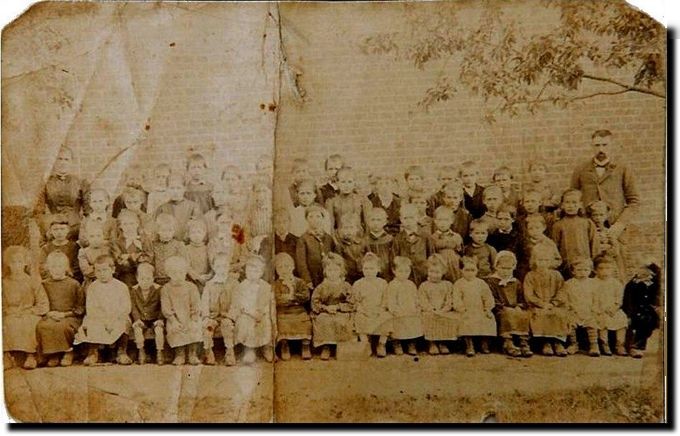
 1898
: Hébert pousse à la création d'une
Société de secours mutuels, refusée
lors d'une
délibération antérieure. Les ouvriers
yainvillais
gagnent suffisamment pour s'acquitter d'une cotisation. En cas
d'accident, ils bénéficieraient plus que l'aide
médicale gratuite et ce ne serait pas à la charge
de la
commune...
1898
: Hébert pousse à la création d'une
Société de secours mutuels, refusée
lors d'une
délibération antérieure. Les ouvriers
yainvillais
gagnent suffisamment pour s'acquitter d'une cotisation. En cas
d'accident, ils bénéficieraient plus que l'aide
médicale gratuite et ce ne serait pas à la charge
de la
commune...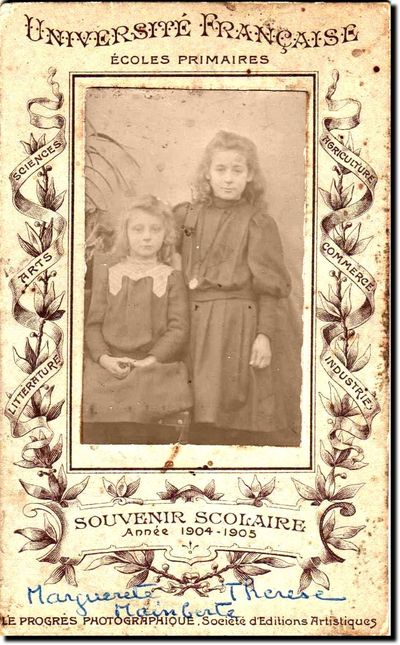

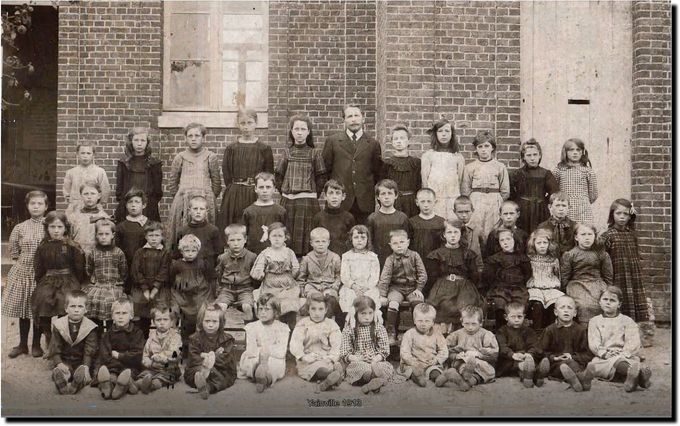
 1921.
La scolarité est alors obligatoire de 6 à 13 ans.
Durant l'été, il y eut une telle
sécheresse que l'on fut dans l'obligation de forer un puits
pour alimenter l'école en eau potable.
1921.
La scolarité est alors obligatoire de 6 à 13 ans.
Durant l'été, il y eut une telle
sécheresse que l'on fut dans l'obligation de forer un puits
pour alimenter l'école en eau potable.


