Les Marescot, voilà une vieille et grande famille de la presqu'île de Jumièges. Au Mesnil une maison a longtemps porté leur nom et ils ont tenu le manoir d'Agnès Sorel. Les Marescot ont donné aussi quelques célébrités au diocèse. Première biographie.

Quiz : où était la maison des
Marescot ?
|
Dans
leur géographie de la Seine-Inférieure, au
chapitre Mesnil, Bunel et Tougard, en 1879, nous affirment : "On montre
encore la maison des Marescot, famille de robe, propriétaire
de la plus grande partie de ce pays. L'un de ses membres,
André Marescot, fut au XVIIIe siècle vicaire
général de Rouen."
Cette maison, on la mentionne encore dans un guide de 1898 : "Près de l'église du Mesnil, à droite, on verra la maison du Marescot qui mérite d' être observée en passant..." |
Le nom est si prégnant qu'il se retrouve ausi dans la toponymie locale. En 1651 est attesté au Mesnil un enclos Marescot. On trouve aussi un cour Marescot à Vimoutiers, dépendance de l'abbaye de Jumièges dont les archives conservent des aveux où des Marescot portent la particule. Alors qui sont donc ces bourgeois ruraux qui semblent occuper une place si privilégiée dans l'histoire gémétique ?
Un vieux clan
 En
1398, Jean Marescot figure parmi ceux qui se partagent la charge de
maréchal de l'abbé de Jumièges. Il
accompagne donc l'abbé dans ses
déplacements. lève hommes quand les guerres
l'exigent, se fait à
l'occasion majordome quand d'illustres invités
séjournent à l'abbaye... En
1398, Jean Marescot figure parmi ceux qui se partagent la charge de
maréchal de l'abbé de Jumièges. Il
accompagne donc l'abbé dans ses
déplacements. lève hommes quand les guerres
l'exigent, se fait à
l'occasion majordome quand d'illustres invités
séjournent à l'abbaye... Au rôle d'imposition de 1413, la famille est pléthorique. On note cette année-là, excusez du peu, trois Jehan Marescot dont un surnommé Fréret, un Raoul Marescot, Jehannot Marescot le jeune, deux Jehanne Marescot en bas âge, Ermion Marescot, deux Rogier Marescot dont un soubzage, Guillaume Marescot, Robin Marescot, Ruart Marescot, Amelot déguerpie (veuve) de Colin Marescot, Pierrette Marescot (soubzage). Un seul échappe à l'impôt, c'est cet autre Rogier Marestot qui est alors varlet des queux à l'abbaye. Autrement-dit cuisinier. |
||
| Bref,
le clan est pléthorique. Qui est
originaire de la région compte forcément des
Marescot dans ses ascendants. C'est le cas d'Amélie Bosquet,
l'auteur de La
Normandie romanesque, c'est aussi le mien. Dans les registes des mariages, les plus anciennes unions sont notées dès 1546 : celle de Philippe Marescot avec une Marie dont le nom n'est pas précisé et puis celle de Nicolas avec Jehanne Pinchard. Dès lors, les Marescot vont donner du travail aux curés de Jumièges et du Mesnil. |
Nous sommes tous des Marescot
Pour ma part, je compte plusieurs Marescot parmi mes devanciers : Valentin, attesté vers 1600 et qui donne les tenants du manoir de la Vigne dont je descends en droite ligne, mais aussi Michèle, épouse de Thomas Mainberte décédée en 1650, Catherine, épouse Nicolas Duparc en 1653, Thierry, époux de Marie Corvée, décédé en 1657, Thomas, époux de Françoise Lecoq à la même époque... |
|
De fieffés marins
En 1452, Robin Marescot, 45 ans, est "carpentier de bateaux". D'ailleurs, les Marescot sont forcément de l'aventure des Jumiégeois à Terre-Neuve. On retrouve leur nom dans les rôles d'armement tout au long du XVIe siècle. L'un de nos Marescot eut au pssage quelques soucis avec l'Anglais :
Dans un mémoire de 1573, "Cristofle Ludom (?) aussi bourgeois de lad. ville, a declaré que depuys quelque temps, il luy a esté prins ung navyre par les pirattes et mené en Angleterre, au havre de Fanwich. Lequel estoit chargé de sel, du port de cinquante cinq tonneaux, ou environ, dont estoit Me Pierres Marescot de Jumieges, qui venait de Brouaige en ceste ville. Lequel navyre est encores de present aud. havre, tout rompu, brizé, et la marchandise vendue par le Vysadmiral d'Angleterre. Et pour autant qu'il a entendu de plusieurs bourgeois de ceste dicte ville, qu'ilz n'ont peu avoir restitution de leurs marchandises aud. païs d'Angleterre, neantmoings les granz fraiz et poursuictes qu'ilz en ont faictes, il n'a point voulu envoyer à ladicte poursuicte, de peur de perdre les fraiz qu'il feroit. Et valoit le tout. tant pour luy que pour ses compaignons, envyron III mil livres."
Peu avant 1600, Valentin Marescot sera l'un des derniers Jumiégeois à faire la traversée. Vers cette époque, on retrouve un homme de ce nom, époux de Perrine de Saint-Audrieu. Il sera pour nous à l'origine de la dynastie. Son fils prénommé comme lui fut trois fois marié. De sa premières alliance avec une Clérel, autre grande famille de la presqu'île, naquit André dont nous allons suivre la lignée.
Au manoir d'Agnès Sorel
André Marescot épousa le 23 novembre 1671 Jeanne Tuvache. Le 13 septembre 1687, avec la qualité de marchand demeurant au Mesnil, il obtient des religieux de l'abbaye le bail du bois taillis de la forêt de Jumièges. Mais le 16 mai 1704, il signe cette fois pour le manoir de la Vigne où réside alors Madame Leguerchois, née Barbe Bec de Lièvre de Quevilly
 .
Esst-ce un renouvellement ? Voilà en tout cas nos Marescot
établis sur le lieu où
Agnès Sorel rendit l'âme dans de
mystérieuses
conditions...
.
Esst-ce un renouvellement ? Voilà en tout cas nos Marescot
établis sur le lieu où
Agnès Sorel rendit l'âme dans de
mystérieuses
conditions... 
Entre temps, André Marescot aura parrainé en 1692 la fille du tout premier organiste de l'abbaye de Jumièges, Michel Lambert. Et c'est avec Lambert que la fille d'André, Marie Madeleine Marescot, sera à son tour marraine chez le chirurgien de Jumièges, Jacques Morin, en mai 1699. Elle a alors 13 ans.

André Marescot avait 73 ans lorsqu'il rendit l'âme au Mesnil. Nous étions le 10 octobre 1710. Le défunt était entouré de ses trois fils :
Jacques, né le 14 décembre 1674 au Mesnil. Le nom de son parrain prénommé Jacques et difficile à déchiffrer, en revanche sa marraine est Madeleine Deshaye, éposue de Pierre tuvache. Jacques alla s'établir à Duclair où il a épousé Marie-Anne Ponty. Il aura deux fils, André, futur vicaire général du diocèse et un autre prêtre plus modeste et prénommé comme lui. A la mort de Jacques, sa veuve épousa Guillaume Lemasson qui fut officier de la duchesse de Berry et vivait également à Duclair..
André né le 10 mai 1688, parrainé par André Tuvache et Anne Pigny. On le retrouve comme vicaire de Hauville.
Philbert enfin qui devient le maître du manoir de la Belle des Belles, né le 26 février 1692 sous la tutelle spirituelle de Philbert Lesergent et Marie Marescot, un couple formé en 1677.
Et Philbert succède à André
 La
façade principale du manoir, édifié en
1325. La
légende voulait que cet arbre ait été
planté par Agnès...
On sait qu'un Pierre
Boutard bénéficie du bail en 1536 et 1548.
La
façade principale du manoir, édifié en
1325. La
légende voulait que cet arbre ait été
planté par Agnès...
On sait qu'un Pierre
Boutard bénéficie du bail en 1536 et 1548.Après les Marescot, on retouvera au manoir Jacques Danger et Marguerite Decaux qui, devenue veuve, y est attestée à la Révolution. Il fut mis en vente le 3 juin 1791 par le district de Caudebec.
Mardi 11 juin 1711. Contrairement à ce que prétend Charles-Antoine Deshayes dans son Histoire de l'abbaye de Jumièges, Barbe de Bec de Lièvre, fille du marquis de Quevilly, épouse Leguerchois, n'est pas décédée au manoir de la Vigne mais dans la paroisse Saint-Patrice de Rouen. Son corps fut transporté le lendemaine en l'abbaye de Jumièges pour être enseveli dans la chapelle de la Vierge. Mais ses meubles, ses armoiries, selon la légende, seraient longtemps restés au manoir où ils passèrent pour avoir appartenus à Agnès Sorel. Que Mme Leguerchois ait vécu au manoir est communément admis. Cependant, avant cela, sa famille possédait un autre manoir sur la presqu'île dont les murs furent vendus aux moines peu avant le décès de Barbe. Du coup se pose la question de la durée de son séjour au Mesnil.
En 1712, Phillebert Marescot, 20 ans, est dit fermier des religieux lorsqu'il se marie avec Magdeleine Tuvache dont il aura plusieurs enfants.
Le 23 juin 1714, François, l'aîné, vint au monde et son acte de baptême, communiqué par Anaïs Dutheil, est fort intéressant. On y apprend, en effet, que le parrain est André Marescot, prêtre vicaire à Hauville, et la marraine Marie-Anne Ponty, épouse de Jacques Marescot, de la paroisse de Duclair.
Le 24 février 1722, Phillibert Marescot signe le bail du manoir de la Vigne. Ayant obtenu une dispense de consanguinité, il s'est remarié avec Marie Anselme en 1717 et convolera encore avec Marie-Anne Boutard en 1725.
Le 16 août 1714, à Rouen, paroisse de Saint-Patrice, un prêtre du nom d'André Marescot est le parrain d'André-Martin Tuvache, fils de Pierre Tuvache, procureur du Roi né à Jumièges et de Madeleine Leboucher, liée aux seigneurs de Honguemare.
En 1720, on apprend encore qu'un prêtre, toujours du nom d'André Marescot, mais exerçant cette fois son sacerdoce à Etoutteville, est le tuteur des enfants de son défunt frère aîné, prénommé Jacques. On procède à l'inventaire de leurs biens au Mesnil. Ils sont considérables.
Et la dynastie continue. Mais va essaimer ailleurs. Le 26 novembre 1736, André Philbert Marescot, fils de Philbert et Madeleine Tuvache, épouse au Mesnil Marie Madeleine Duparc, et va s'établir à Bliquetuit.
 Les
Marescot sont toujours au manoir de la Vigne quand, en 1748,
éclate l'affaire des pigeons. Excédés
par le volatiles des moines qui ravagent leurs semences, les paysans
tendent des pièges, tirent au fusil. L'abbaye les traduit
devant la justice.
Les
Marescot sont toujours au manoir de la Vigne quand, en 1748,
éclate l'affaire des pigeons. Excédés
par le volatiles des moines qui ravagent leurs semences, les paysans
tendent des pièges, tirent au fusil. L'abbaye les traduit
devant la justice. Catherine Merre, la femme de Philippe Robert,
journalière, succède à
Hébert. La cinquantaine, elle demeure au Mesnil. Elle aussi
a entendu le coup de feu sur les pigeons. C’était
dans la pièce de terre nommée la Mare,
près de la masure à Cottard. C’est
là que les pigeons viennent ordinairement boire. Elle
n’a pas vu le tireur. Simplement le fils Cottard qui
ramassait les victimes dans son bonnet. Avant de s’en
retourner chez lui.
Catherine Merre, la femme de Philippe Robert,
journalière, succède à
Hébert. La cinquantaine, elle demeure au Mesnil. Elle aussi
a entendu le coup de feu sur les pigeons. C’était
dans la pièce de terre nommée la Mare,
près de la masure à Cottard. C’est
là que les pigeons viennent ordinairement boire. Elle
n’a pas vu le tireur. Simplement le fils Cottard qui
ramassait les victimes dans son bonnet. Avant de s’en
retourner chez lui. Mais elle ajoute qu’elle a aperçu plusieurs fois Etienne Cottard se promener dans la campagne avec son fusil. Il y a quelque temps, au manoir de la Vigne, propriété des religieux exploitée par Marescot, elle l’a vu faire feu sur les pigeons du fermier. Bref, l’accusation se précise…
Le "Sieur" Philibert Marescot rendit l'âme, sans doute au manoir de la Vigne, le 6 avril 1758. Plusieurs membres de sa famille, dont au moins religieux, signent le lendemain le registre. C'est le dernier acte concernant la famille au Mesnil-sous-Jumièges. Elle s'éteignit peu après dans la commune voisine.

Marescot, l'homme fort du diocèse
Selon Bunel et Tougard, le représentant le plus prestigieux est André Marescot. Il dirigea le diocèse de Rouen. Voici la notice biographique que lui consacre Théodore Éloi Lebreton,
MARESCOT (André), né à Duclair, près de Rouen, en 1709, se distingua, dans le cours d'études qu'il fit chez les Jésuites, par une grande piété et beaucoup d'intelligence. Choisi par le cardinal de Saulx de Tavannes, archevêque de Rouen, pour diriger les études des jeunes clercs, il fut ordonné prêtre par ce prélat, et nommé curé de la paroisse de Saint-Nicaise de Rouen. Le jeune pasteur apporta, dans ces fonctions, une activité infatigable, et, plein de charité, il engagea son patrimoine pour subvenir aux besoins des pauvres de sa paroisse et de ceux des hôpitaux. Pourvu d'un canonicat dans l'église métropolitaine, l'abbé Marescot devint professeur de théologie, et se livra avec talent et succès à l'éloquence de la chaire. Dans sa jeunesse, en 1731, cet honorable ecclésiastique avait été couronné à l'Académie des Palinods de Rouen pour une pièce de poésie latine, ayant pour sujet La Chaste Suzanne.
Il mourut à Rouen, le 22 juin 1780, et fut inhumé dans la Cathédrale.
(V. Nouv. eccl., 1740, et Annonces de Norm. du 30 juin 1780.)
Si l'on se fie à certains auteurs, c'est précisément le 18 décembre 1709 que Marie Anne Ponty, épouse de Franois Marescot, accoucha de son fils André, le dignitaire. Elle mettra au monde un autre garçon, Jacques, qui lui aussi sera ecclésiastique. Veuve, elle s'est remariée avec Guillaume Masson.
Ses dates...
1731 André Marescot est l'un "des concurrents heureux pour les prix, des Palinods. L'Académie du Puy de l'Immaculée Conception lui accorda celui de l'épigramme latine dont le sujet était La chaste Suzanne." (Philippe Guilbert, Mémoires biographiques et littéraires)
1734. Publication d'une thèse.
Pâques 1735. André Marescot est ordonné prêtre. Il est dit de Duclair. Ce qui est sans doute vrai puisque sa mère y habitait. Mais est-ce vraiment son lieu de naissance ? Chauvin comme nous le sommes, on est tenté de pencher pour Le Mesnil.
13 janvier 1736. Il prend possession de la cure de Notre-Dame de Quévreville-la-Milon, vacante par le décès de Jacques Lévesque. L'église était certainement en mauvais état puisqu'elle s'effondra d'elle-même à la Révolution. Cette paroisse fut rattachée à Saint-Jacques-sur-Darnétal.
14 janvier 1739. Prise de possession de la cure d'Anglesqueville-la-Bras-Long. Son église est dédiée à Sainte-Anne.
10 août 1739. Prise de possession de Saint-Nicaise, à Rouen, par permuttation avec Joseph Bénard dans des circonstances peu glorieuses comme on le lira plus bas.
1740. Les Nouvelles ecclésiastiques qualifient d'erronée sa thèse de 1734 et surtout l'accusent ainsi : "Fait lire aux jeunes Clercs les comédies impies des Jésuites ; empêche les Ecclésiastiques non décidés en faveur de la Bulle de dire la Messe dans son Eglise." La même revue lui reproche d'avoir été le protecteur d'un diacre trop préoccupé par les plaisirs terrestres et en conflit avec le curé de Sainte-Valéry-en-Caux.
1749. André Marescot intervient dans une grande mission à Duclair.

26 avril 1751. Il est remplacé à Saint-Nicaise, dont il a démissionné, par François Anfrie.
9 octobre 1753. Nommé au canonicat vacant par démission de Rogier de Neuilly.
13 octobre 1753. Reçoit la prébende de Clais, vacante par la démission de M. Artur-Richard Dillon, nommé à l’évêché d’Évreux.
11 mars 1759. Nommé promoteur.
24 mars 1765. Nommé au personat de Mirville, vacant par le décès de Jean Louis de Roquigny de Bulonde.
5 novembre 1765. Desmarquets, historien de Dieppe, se plaint du vicaire de Saint-Saens, dont étaient très mécontents les propriétaires et habitants et M. d’Oissel, le seigneur de la paroisse : « M. Marescot, vicaire général, veut, sous prétexte que le rituel dit que le prosne doit se faire intra solemnia, que le curé de Saint-Saens le fasse après l’évangile. Le curé de Saint-Saens, suplié par tous les habitants et propriétaires de continuer de le faire après la procession, a répondu à M. Marescot conformément aux désirs de ses paroissiens. A. Saint-Saens, le prosne s’est fait de toute ancienneté après la procession. »
28 juin 1766. Prend la prébende canoniale vacante par le décès dudit Sehier.
3 juillet 1766. Prise de possession de la prébende de Braquemont.
7 août 1766. Après sa démission de la prébende canoniale, il est remplacée par Louis Pierre de la Bruyère, du diocèse de Bourges.
30 mars 1768. André Marescot, licencié en l’un et l’autre droit, nommé assesseur en l’officialité.
15 juin 1773. Lettre de l’arpenteur Pernet, à M. Marescot, chanoine prebendé de Braquemont : « Vous avez 434 acres de terre 2 vergées et 35 perches de terre à dîmer, depuis le Camp de César jusqu’à Belleville... Le total du terrain de Braquemont, non compris les terres nouvellement labourées dans la Cité de Lime ou Camp de César, est de 503 acres 1 vergée 11 perches.»
Etat et inventaire des contrats, aveux, cueilloirs et autres titres, notes et renseignements de la seigneurie et haute justice de Braquemont et du Pollet en partie, appartenant à messire André Marescot, chanoine de Notre-Dame de Rouen, à cause de sa prébende de Braquemont, 2e portion.
Date non précisée : Mémoire de M. Marescot, prébendé de Braquemont (2e portion) et, en cette qualité, gros décimateur et patron de la paroisse, contre Nicolas Gilles, vicaire de Braquemont, qui s’opposait à l’exécution des dits actes.
1778. Il fait obtenir la cure du Mesnil-sous-Jumièges à Louis Lefaucheur, vicaire de Saint-Maclou, chapelain de la duchesse de Gesvres, à la Vaupalière. Très bon prédicateur, il sera élu à la Révolution et épousera sa bonne...
1780. A Rouen, Marescot habitait rue de la Grosse-Horloge, paroisse et presbytaire de Notre-Dame-la-Ronde. Vers 1780, il intervient contre un particulier qui s'était piqué de faire l'école à Sainte-Marguerite-sur-Duclair au lieu et place du curé et de son clerc.
22 juin 1780. Décès d'André Marescot. Il est remplacée dans son canonicat dès le 28. On note ce document dans les archives départementales :"Aux héritiers de M. Marescot, chanoine, 100 livres pour le pain de matines qui leur est dû pour l’année échue au 22 juin 1781."
Livres achetés à la vente du chanoine Marescot : 18 paquets de journaux de Verdun, 9 livres ; 3 volumes in-folio de Maldonat, 10 livres, etc
Le digesteur du curé Marescot
Le Mercure de France nous livre une anecdote sur Marescot : Les travaux, de notre Société ayant pour but principal, le bien public, nous nous appliquons non seulement aux Sciences & aux Arts à la perfection de l'agriculture & du commerce, mais encore à tout ce qui peut procurer l'aisance à nos Concitoyens, le soulagement aux misérables.
C'est dans le dessein de remplir une partie de ces engagements, & par la fuite des projets économiques qui lui font propres que M. Queriault, notre ancien Secrétaire, proposa le 11 Octobre 1758, à une assemblée extraordinaire de notre Société, un moyen de pourvoir à peu de frais à la subsistance des pauvres.
II dit après Messieurs Papin, Nollet & Polinière qu'on pouvait facilement, dans la machine connue sous le nom de Digesteur de Papin, faire avec des os, matière de pur rebut pour l'ordinaire, & une dépense d'ailleurs très modique, une quantité de bouillons & de gelées suffisantes pour la nourriture d'un grand nombre de pauvres, & passant de cet avantage particulier au bien général que produirait cette opération ; il ajouta, que vu la quantité immense des os qui se perdent dans les grandes villes, on pourrait en faire des tablettes, qu'il serait facile de conserver & qu'on transporterait au besoin dans toutes les parties où leur ressource serait nécessaire.
Nous nous appliquâmes dès lors à mettre en pratique les vues théoriques de notre Académicien & pour ne pas paraître vouloir enlever à d'autres les louanges & l'estime qui leur font dues pour les tentatives qu'ils ont faites dans le même genre, nous avouons avec sincérité que nous fûmes instruits par M. l'Abbé Nollet des premiers essais de M. Marescot, chanoine de l'Eglise de Rouen ; nous nous adressâmes à lui tant pour savoir la manière dont il opérait que pour nous informer des raisons qui l'avaient engagé à discontinuer ses opérations & à n'en point faire part au Public.
La générosité de M. Marescot le porta à nous envoyer non seulement un précis de ses opérations, mais encore son Digesteur qu'il nous a ensuite cédé.
Nous avons appris depuis par une Lettre de M. Voegeon, membre de l'Académie de Rouen , que c'était lui qui en 1753 avait fait l'essai des bouillons d'os & qu'il avait engagé M. Marescot, alors Curé, à se prêter à cette opération en faveur des pauvres de sa Paroisse.Cependant ces premiers essais n'avaient eu aucune fuite...
Portrait au vitriol
En guise d'éloge nécrologique, les Nouvelles ecclésiastiques brosseront un noir portrait d'André Marescot.
M. André Marescot Chanoine de la Cathédrale, mort au mois de Juin de l'année dernière à l'âge de 71 ans, a été aussitôt après préconisé dans les Annonces de la Haute et Basse Normandie (l'ancêtre de Paris-Normandie), comme singulièrement recommandable par sa piété, ses lumières, ses talents, son zèle, les services rendus au Diocèse. Quoique le peu qu'on trouve déjà dans nos Nouvelles au sujet de cet Ecclésiastique soit suffisant pour réduire ces éloges à leur juste valeur, il est à propos de montrer plus en détail combien la vérité est peu respectée dans ces sortes de panégyriques.
M. Marescot fit ses études chez les Jésuites de Rouen & se pénétra tellement de leurs principes & de leurs maximes, qu'il ne lui manquait que la robe pour leur être entièrement semblable. Aussi conçurent-ils pour cet élève une amitié particulière. Ils ne tardèrent pas à le recommander à M. de Tavannes, qui sur leur témoignage le choisit, avant même qu'il fût prêtre, pour diriger les études des jeunes Clercs, c'est à dire, pour leur expliquer & leur faire répéter les cahiers des Jésuites. L'Archevêque le récompensa bientôt, en le nommant à la Cure d'Anglesqueville- l'Esneval dans le pays de Caux, près le Havre-de-Grâce.
| Les
Grands-Vicaires Bridelle, Terrise & Rose qui, de concert avec
les Jésuites, avaient résolu d'introduire
l'ignorance dans le Diocèse, sous prétexte d'y
établir le bon ordre & la soumission due
à l'Eglise, pensèrent qu'il ne fallait pas
négliger un homme si propre à les seconder.
Lui-même gémissait de voir ses talents enfouis
dans une campagne éloignée de la Capitale. Il fut
donc question de le faire Curé de St.-Nicaise, l'une des
plus grandes Paroisses de Rouen. M. Joseph Bénard, titulaire de ce Bénéfice depuis plusieurs années, n'avait ni le don de la parole ni les autres talents nécessaires à un Curé, il montrait d'ailleurs peu de zèle pour les intérêts de la Bulle Unigenitus; & cette indifférence, péché en matière grave pour les simples Fidèles, était alors un crime irrémissible dans un Curé surtout de Rouen, & pour cela seul il méritait d'être destitué. Les Grands-Vicaires soulevèrent contre lui son Vicaire, nommé Berthelot, homme mondain, qu'ils flattèrent de l'espérance de lui succéder. |
 Le nom des Marescot est porté
ailleurs qu'à Jumièges. Nous voyons en 1239,
Renaud Marescot, bourgeois de Rouen et paroissien de Saint-Eloi,
autoriser les moines du Valasse à attacher leurs navires
à son quai. En 1326, les geoles de Rouen sont tenues par
Adam de Marescot. Rouen comptera aussi un botaniste
distingué de ce nom. Le nom des Marescot est porté
ailleurs qu'à Jumièges. Nous voyons en 1239,
Renaud Marescot, bourgeois de Rouen et paroissien de Saint-Eloi,
autoriser les moines du Valasse à attacher leurs navires
à son quai. En 1326, les geoles de Rouen sont tenues par
Adam de Marescot. Rouen comptera aussi un botaniste
distingué de ce nom. Une famille noble porte le nom de Marescot. Elle est d'origine italienne et d'implantation tardive à Paris et en Normandie. En 1628, un maître des requêtes du nom de Marescot échappa à une émeute des tanneurs rouennais lourdement taxés sur les cuirs. Il se réfugia au Parlement tandis que son carrosse était vandalisé et précipité dans la Seine. Les Marescot de Rouen étaient représentés, en 1629, au Parlement de Normandie, par le conseiller Michel de Marescot, sieur du Mesnil Durand. L'histoire retient aussi un général Marescot, figure de la Révolution, né à Tours et sans lien apparent avec la Normandie. |
Ce Vicaire engagea dans son parti les Supérieurs du Séminaire de St.-Nicaise & quelques autres Prêtres de la Paroisse qui formèrent tous ensemble une ligue formidable contre le pauvre Curé.
M. Berthelot ne cessaít de dire que pour convertir le Curé, le Clergé & toute la Paroisse, il ne fallait pas moins qu'une ample Mission de Jésuites. Elle vint en 1737 , conduite par le fameux P. Duplessis & dura pendant les mois de Juin, Juillet, Août & Septembre. Les NN. du 3o Juin de la même année ne donnent qu'une légère idée des excès, des désordres & des profanations qui s'y commirent.
M. Berthelot ayant été pourvu en 1739 de la Cure de St-Etienne-des Tonneliers, fut remplacé dans le Vicariat de St Nicaise par M. Outin Chapelain de l'Hôpital Général. Celui-ci, quoique flatté des mêmes espérances que son prédécesseur, ne montra pas le même zèle; ce qui détermina les Grands-Vicaires à lui substituer M. Marescot, et à faire passer sur sa tête la Cure de S-Nicaise.
M. Bénard étant peu âgé & peu disposé à céder sa place, il fallait lui trouver des crimes pour l'obliger à permuter. Sa conduite fut épluchée avec rigueur; le P. Duplessis et ses compagnons fournirent des témoins; mais leurs dépositions ne s'accordaient pas. Une parente du Curé allait souvent au Presbytère, pour veiller à son ménage, parce qu'il n'y entendait rien. On en prit occasion de tramer contre le Curé l'accusation la plus atroce: on surprit la religion de M. de Pontcarré, Premier Président du Parlement; par ordre de ce Magistrat, la femme fut enlevée avec éclat en plein jour, fit conduite à l'Hôpital. Le mari n'en fut pas plutôt informé, qu'il alla réclamer sa femme à. l'audience du Magistrat ; & justifia si bien sa conduite qu'il obtint fur le champ son élargissement.
Alors les Grands-Vicaires ne balancèrent plus à brusquer leur entreprise. Il s'agissait d'engager M. Bénard à permuter avec M. Marescot. On en vint à bout à force de caresses & de menaces le 14 Mai 1739. Mais cet acte était si peu volontaire, que dès le lendemain M. Bénard en fit la révocation chez le même Notaire.
| M.
Marescot de son côté tâchait de faire
accroire qu'il était bien aise que l'affaire fut
manquée. Mais tandis qu'il amusait ainsi ses dupes, les
principaux auteurs de cette lâche manœuvre ne
négligeaient rien pour la consommer. Le 5 juin à
six heures du matin, M. Bénard fut conduit par un
Ecclésiastique chez une .personne vendue aux
Grands-Vicaires. Là, intimidé de nouveau
& plus que jamais, il se désista de sa
révocation; & de peur qu'il ne se
rétractât une troisième fois, on le
retint dans la même maison , d'où on ne le laissa
sortir que le lendemain & M. Marescot eut son Visa le
même jour en récompense des services
signalés qu'il avait rendus & rendait encore au
Diocèse, dans la direction des études des jeunes
Clercs. En prenant possession le 11 Août, il notifia
à M. Bénard qu'il eut à. partir
dès le lendemain pour Anglesqueville. L'ordre
était aussi absolu que précis: le pauvre M.
Bénard s'exécuta le jour même,
& mourut quelques mois après dans sa nouvelle Cure,
accablé de chagrin. C'est donc par ces voies odieuses que M. Marescot parvint à la Cure de St. Nicaise. |
  Avis à MM. les maires des communes riveraines de la Seine. MM. les maires sort invités à faire rechercher, sur le territoire dn leurs communes respectives le cadavre du sieur Marescot, ex-commissaire-priseur à Rouen, qui s'est noyé le 27 décembre dernier , en patinant sur la Seine, à la hauteur du hameau de Lescure Il était âgé de 28 ans, taille de 5 pieds 5 pouces, cheveux châtains, favoris noirs et courts; vêtu d'une redingote bronze foncé, garnie en soie avec colet de velours, d'un gilet de couleur fond blanc, cravate noire, pantalon bleu, bottes à la russe, avec des patins neufs aux pieds; ayant sur lui une montre à boîte d'or avec une chaîne en or et une chaîne de sûreté; plusieurs cachets et clefs en or, et à sa chemise deux épingles également en or. La famille du sieur Marescot promet 600 francs aux personnes qui pourraient retrouver son cadavre, et qui, dans ce cas, devraient en donner connaissance à Rouen, chez Georgem , commissaire priseur; à la Mailleraye, chez M. Tuvache, maire; ou à Caudebec, chez Mlle Marescot, rue des Belles-Femmes. Préfecture
de la Seine-Inférieure, 1822.
|
La manière dont il s'y est conduit répond à cette entrée. II entreprit aussitôt de tout changer dans la Paroisse, & de faire main-basse fur tous les établissements que ses prédécesseurs avaient formés de concert avec les Paroissiens. Les fondations étaient distribuées comme en titre de Bénéfices entre les Prêtres de son Clergé. Il prétendit qu'elles devaient lui être remises, pour en disposer à sa volonté. Les Registres du Bailliage de Rouen, du Parlement & du Conseil du Roi sont chargés de nombre de Sentences & d'Arrêts sur Requête qu'il sut obtenir pour autoriser cette invasion. En même temps, il introduisit quantité de Saluts du S. Sacrement & de dévotions Jésuitiques dont il eut soin de relever l'éclat par un abondant luminaire, à l'exemple de ses anciens Maîtres. C'était à l'entretien de cette espèce de luxe qu'il employait les fondations. D'ailleurs insinuant & patelin par caractère, il savait gagner la confiance des personnes qu'il confessait, se procurer des dons, des legs testamentaires, comme le seul moyen de l'exempte, disait-il, de vendre son patrimoine pour secourir les pauvres. Il fut quatorze ans Curé de S.-Nicaise.
 M. de Tavannes, suivant l'Auteur de
l'éloge, le nomma Chanoine pour le mettre en état
de rétablir sa santé, que les travaux de la
charge Pastorale avaient altérée; &
néanmoins , suivant le même Ecrivain, M.
Marcescot, ne pouvant contenir son zèle, joignit
à l'assiduité exemplaire au Chœur, les
occupations pénibles de la Chaire & du
Confessionnal; il s'appliqua plus que jamais à inspirer aux
jeunes Ecclésiastiques le goût des Saintes Lettres
par des Conférences réglées sur
l'Ecriture, qu'il avait commencées étant
Curé, et qu'il a continuées jusqu'à sa
mort. La vérité est que malgré ces
doctes Conférences, l'ignorance règne parmi le
jeune Clergé, au point que M. Desboussays, Chanoine
& Professeur de Théologie, ne put
s'empêcher de s'en plaindre un jour à M. le
Cardinal de la Rochefoucault. (portrait ci-contre)
M. de Tavannes, suivant l'Auteur de
l'éloge, le nomma Chanoine pour le mettre en état
de rétablir sa santé, que les travaux de la
charge Pastorale avaient altérée; &
néanmoins , suivant le même Ecrivain, M.
Marcescot, ne pouvant contenir son zèle, joignit
à l'assiduité exemplaire au Chœur, les
occupations pénibles de la Chaire & du
Confessionnal; il s'appliqua plus que jamais à inspirer aux
jeunes Ecclésiastiques le goût des Saintes Lettres
par des Conférences réglées sur
l'Ecriture, qu'il avait commencées étant
Curé, et qu'il a continuées jusqu'à sa
mort. La vérité est que malgré ces
doctes Conférences, l'ignorance règne parmi le
jeune Clergé, au point que M. Desboussays, Chanoine
& Professeur de Théologie, ne put
s'empêcher de s'en plaindre un jour à M. le
Cardinal de la Rochefoucault. (portrait ci-contre)M. Marescot, Archidiacre, Grand-Vicaire & cousin du défunt, fut témoin de ces plaintes; & pour détourner son Eminence d'avoir égard , il dit magistralement: Monseigneur, Monseigneur, j'aime mieux des ignorants que des savants , ils nous sont plus soumis, parole plus convenable à un locuteur de Mahomet qu'à un Ministre de J. C. Elle montre aussì que ces deux dignes parents étaient à l'unisson pour le goût de gouverner l'Eglise à la turque; avec cette seule différence que l'un plus actif travaillait à établir l'ignorance, en faisant semblant de la combattre, et que l'autre se contentait de lui applaudir.
| L'Auteur
de l'éloge, qui passe sous silence l'invasion des fondations
de la Paroisse S. Nicaise, fait un grand mérite à
l'ancien Curé d'avoir fait réunir beaucoup de
Chapelles de la Cathédrale à la Mense
Capitulaire, et d'avoir consommé cette entreprise par son
activité et par sa prudence. Des Mémoires imprimés sur cette affaire prouvent qu'il n'y eut jamais union plus injuste et plus criante que celle-la. M. Marescot allégua pour motif l'augmentation du Culte divin. Cependant l'Office n'a jamais été plus mal célébré qu'il l'est depuis. On dit que cet ancien Curé lui même s'en est repenti au lit de la mort, et qu'il en a fait amende honorable. Par son Testament, il a donné à la Bibliothèque de la Cathédrale les Livres qu'il avait confisqués comme mauvais et pernicieux. Parmi quelques Livres impies, on y remarque le Nouveau Testament du P. Quesnel et l'Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique de M. Racine. Le reste de sa Bibliothèque a été vendu publiquement. II y avait tant de vieux Livrets méprisables à tous égards, qu'on entendait souvent à la vente : Que de bouquins ! Ses amis même en riant disaient la même chose. C'est probablement dans ces sources qu'il puisait ses Conférences, puisqu'il n'avait qu'un seul Père de l'Eglise, S. Bernard, et encore de l'ancienne édition... |
 Autre anecdote sur un Marescot. Elle date de l'occupation anglaise...  Si les Anglais prenaient des Français armés, ils disaient, de ceux qui n'avaient pas le moyen de payer leur rançon, qu'ils étaient pris en brigandise et les pendaient sans pitié. Gilles le Petit, qui se trouvait dans ce cas, fut exécuté à Caudebec, et Gilles Marescot, son compagnon, se sauva du gibet, parce que le bourreau venant à mourir, il consentit à le remplacer. Lettre de Hue Spencer, écuyer, bailli de Caux, au vicomte de Caudebec, datée du 17 mars 1429 pour faire payer à son lieutenant 12 livres tournois pour avoir appréhendé en brigandise les nommés Gilles Marescot, demeurant près Bahieux et Nicolas Le Petit, de la duchié de Bar, lesquels résidaient en la ville de Louviers, alors désobéissante au roi. L'acte porte que ledit Le Petit fut pendu au gibet de Caudebec mais comme il n'y avait pas de maître de la haute justice dans ladite ville et que la cause dudit Gilles Marescot avait paru piteuse aux juges des assises il fut établi et ordonné maître de la haute justice du roi dans ledit bailliage. L'histoire ne dit pas si Marescot pendit son compagnon... 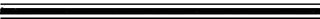
|
Un frère pauvre curé...
André Marescot avait donc un frère curé prénommé Jacques. Il exerça son sacerdoce à Saint-Ouen-de-Thouberville où il fut aussi recteur de la confrérie du Roumois.
En 1759, on le retrouve curé de Saint-Paul de la Haye. C'est une paroisse de 26 feux. La moitié des habitants est réduite à la mendicité, l'église est dénuée de tout, sans chaire, sans confessionnal et sans bancs.
En 1772, Jacques Marescot était toujours prieur et curé de Saint-Paul de la Haye
...mais un cousin riche !
André et Jacques Marescot avaient pour cousin une autre sommité ecclésiastique. Philibert-Pierre Marescot, et son prénom trahit ses origines gémétiques, fut docteur en théologie de la Faculté de Paris, prieur de Manthe-en-Dauphiné, chanoine de Rouen... voici sa carrière.
Septembre 1738. Philibert-Pierre Marescot est ordonné parmi 47 tonsurés.
Septembre 1744. Signification de son grade.
18 septembre 1750. nouvelle signification de son grade.
30 juin 1752. Reçoit la cure de Saint-Sauveur, vacante par la démission de Thomas Le Rat.
1er août 1752. Prise de possession de la cure de Saint-Sauveur.
31 octobre 1753. Nommé vice-gérant du promoteur métropolitain.
13 juillet 1759. Prend possession de la prébende canoniale de Baillolet par démission de Martial Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire.
22 juillet 1759. Promoteur diocésain et métropolitain.
21 mai 1760. Résigne de Saint-Sauveur où il est remplacé par Nicolas Le Hot.
Voici ce que dit de lui Léonard Sonnes : "Monsieur Marescot, qui, depuis l751 étoit Curé de S. Sauveur, où il a vu avec tranquillité, pour ne pas dire permis, les abus ridicules dont il est parlé au sujet des Saluts solennels du S. Sacrement qui se disent dans cette Paroisse, vient d'avoir un Canonicat de la Cathédrale.
Il a laissé pour Vicaire à S. Sauveur le sieur Morel, qui n'a aucun goût pour l'étude, dont toute la bibliothèque ne consiste qu'en quelques tomes dépareillés de l'Histoire du Peuple de Dieu, & d'une ignorance si crasse, que, malgré la facilité des Grands-Vicaires de M, de Tavanes à recevoir des Sujets tout-à-fait incapables, il a été refusé plusieurs fois pour les Ordres. Au surplus c'est un homme soumis, & ce rare sujet a mérité les égards du sieur Marescot.
Des Paroissiens faisant un jour des reproches à leur Curé sur son mauvais choix, il répondit : « Bon, si j'avois une condition meilleure, je la lui donnerois. C'est mon homme de consiance. Le Curé Esmangard a pour homme de consiance le sieur Saint-Ouen, il étoit bien juste que le sieur Marescot, qui vouloit s'élever, marquât son goût & son discernement par le choix de gens de consiance. Digne Promoteur de l'Officialité ! On peut dire qu'il est Chanoine par vocation, car on le voit souvent dormir, rire ou causer pendant l'Office Divin."
20 novembre 1760. Nommé aux fonctions de vicaire général pour l'abbé de Saint-Evroult, évêque de Rennes.
18 janvier 1763. Nommé à l'archidiaconé d'Eu vacant par démission de Marc Antoine de Noé, évêque de Lescar.
6 avril 1763. Vice gérant de l'officialité diocésaine.
21 juillet 1764. Nommé aux fonctions de vicaire général pour Pierre-Cosme de Savary de Brèves, abbé d'Aumale.
27 avril 1767. Nommé official diocésain jusqu'en 1779.
28 avril 1785. Toujours archidiacre d’Eu, il est nommé président de la Chambre du clergé, en remplacement de M. Terrisse, décédé.
17 novembre 1787. Participe au couvent des Cordelier à l'assemblée provinciale voulue par Louis XVI et présidée par le cardinal de La Rochefoucault.
28 septembre 1788. Décède en son domicile de la rue des Charnoies. Inhumé le lendemain. Ses meubles furent vendus.
Le Journal de Rouen fit sa une sur sa disparition : "Ses vertus, sa religion et ses succès dans le cours de sa liecence l'avaient fait choisir par feu Monseig. le Cadinal de Tavannes pour l'attacher à ce vaste diocèse en qualité de Promoteur. Son Eminence Monseigneur le Cardinal de La Rochefoucault ne tarda pas à sentir, de même que son prédécesseur, l'utilité de ce vertueux ecclésiastique, à lui accorder sa confiance, en le faisant son official et son Vicaire-Général. Son goût pour le travail, sa justice et ses connaissances ont justifié le choix de ce prélat. La résolution extraordinaire, et l'on peut dire héroîque, qu'il a montrée de se faire opérer de la pierre, presque au moment om il a appris qu'il avait cette maladie, avait alarmé particulière S.R et tous ceux qui connaissaient, mais sa mort et les larmes qu'elle leur a causées à tous, prouvent plus qu'on ne peut dire combien il était aimé et combien il méritait de l'être."
Post-Scriptum
Le
chanoine Tuvache de Vertville était un petit-neveu par
alliance d'André Marescot. 
Plus près de nous, notons enfin que les Marescot du manoir de la Vigne comptent parmi leurs descendants André Lavoinne homme politique né le 1er juillet 1867 et décédé le 11 novembre 1952 à Boudeville Agriculteur-éleveur à la ferme du Bosc-aux-Moines, conseiller général du canton de Doudeville, il est député de Seine-Inférieure de 1912 à 1924, déposant une proposition de loi afin que le 11 novembre soit déclaré jour férié. Il est sénateur de 1927 à 1940. Le 10 juillet 1940, il vote les pleins pouvoir à Pétain. Rapidement, il s'oppose à Laval. André Lavoinne était président de l'Association des éleveurs de la Seine-Inférieure, président d'honneur de la Société centrale d'agriculture, du Herd-Book normand. Il était officier de la Légion d'honneur.
Notes généalogiquesOn voit en 1593 une Alizon Marescot épouser André Beaufils à Jumièges sans autre précision.
Au manoir d'Agnès Sorel, André Marescot, notre premier du nom et Jeanne Tuvache ont eu comme nous l'avons dit plus haut Jacques, André et Phillebert. Mais aussi Marie, le 19 octobre 1677, parrainée par Pierre Tuvache et Madeleine Clérel, André né le 8 octobre 1679 avec une sœur jumelle prénommée Anne, parrainés l'un par Jean Pigny et Marie Tuvache, l'autre Guillaume Clérel et Magdeleine Levillain.Valentin, né le 14 juin 1684 et parrainé par Gaspard Mustel et Anne Patin, épouse de Pierre Tuvache, Marie Madeleine, née le 22 février 1686 et parrainée par Philebert Clérel et Magdeleine Tuvache, Pierre, né le 8 avril 1690 et parrainé par Pierre Deconihout et Marie Anne Hue.
A Duclair, nous avons recherché la naissance d'André Marescot, 3e du nom, futur vicaire général. Elle est introuvable. En revanche, au Mesnil, un acte de baptême de 1714 confirme qu'il était bien fils de Jacques Marescot, établi à Duclair, et de Marie-Anne Ponty. Cette dernière mourut à Duclair le 30 juin 1748 à l'âge de 60 ans. Elle était veuve en seconde noce de Guillaume Lemasson. Les témoins de son décès furent André Marescot, curé de Saint-Nicaise, à Rouen; enfant de la défunte et Jacques Marescot, lui aussi enfant de la défunte.
Malheureusement, nous ne retrouvons pas de mariage Marescot-Ponty. Seuls, deux actes de tutelle de la haute justice concernent Guillaume Lemasson et Marie Anne Ponty, l'un en date du 23 mars 1745 (199 BP 11) et l'autre du 23 avril 1748, peu de temps avant la mort de la mère. Le prénom d'un enfant est mentionné : André. Sa branche paternelle : Robert Lemasson, oncle, Yvetot, Guibert et Adrien Orenge, Yvetot, cousins germains, Thomas Marchand, de Saint-Denis de Rouen, beau-frère. Il a épousé M. A Lemasson (199 BP 20).
Un Guillaume Lemasson est mort à Duclair le 11 décembre 1738 à l'âge de 19 ans et les témoins furent Pierre Ponty et Laurent Maupoint. Mais le mari de Marie Anne Ponty, veuve Marescot, est certainement le Guillaume Lemasson qui décède à Duclair le 11 mars 1745 à l'âge de 66 ans. On le dit officier de feu Mme la duchesse de Berry. Son frère Robert est témoin en compagnie de Jean-Baptiste Durdent.
La naissance d'André Marescot, "l'homme fot du diocèse", reste donc à trouver.
En 1750, un avocat, maître Marescot, défend les Boutard au tribunal de Duclair face aux Porgueroult, leurs voisins, qui les assaillent d'insultes.
André Philbert Marescotet Marie Madeleine Duparc s'établirent à Bliquetuit. En 1776, André Philbert participe à un conseil de famille pour désigner un tuteur aux enfants du passeur de bac de Jumièges, Denis Mustel, avec qui ils est en parenté.
André Philbert et Marie Madeleine eurent :
"On a découvert des sépultures antiques sous la crête d'un coteau qui domine le chemin du Roi, dans un ancien fief appartenant à M. Marescot de Bliquetuit. Auprès des squelettes , privés de sarcophages, on a recueilli des boucles en bronze, des médailles et divers objets en fer..." (Société des Antiquaires de Normandie, 1837).
La famille essaima à Bourville, Doudeville, Anglesqueville-la-Bras-Long... On note encore au XIXe un Marescot maire et propriétaire à la ferme de Routes, dite Petitville, commune de Doudeville. En 1868, trésorier de l'église, Adolphe Marescot fut parrain de la cloche.
▲
Haut de page
