Par Laurent Quevilly-Mainberte
210 habitants, pas d'église, pas d'école, pas de revenus... Après la Révolution, l'administration voulut annexer Yainville à une commune voisine. Voici comment les Yainvillais restèrent indépendants...
Et puis les Yainvillais ne surent pas saisir la perche qui leur était tendue. On avait choisi leur commune pour être le chef-lieu d'arrondissement de l'instruction publique. Arguant d'un manque de local pour accueillir les élèves et un instituteur, nos édiles laissèrent filer cette opportunité au Trait.
Un banal incident de frontière
Tout commença par un incident de frontière. Entre Yainville et Le Trait, la ligne de démarcation était mal définie. Quand un géomètre traça une nouvelle ligne, les élus traitons examinèrent la question le 28 septembre 1826.
Cliquer pour agrandir
"Il résulte que le conseil, après avoir examiné la portion de terrain appartenant aux propriétaires du Trait et située sur la commune de Yainville, que cette partie de terrain se trouve, tant en terre labourable qu'en taillis, au nombre de 106 acres d'après le résultat que nous présente le géomètre, mais qu'il est bon d'observer à Monsieur le sous-préfet que la ligne de démarcation que nous présente ce même géomètre entre notre commune et celle de Yainville ne peut guère subsister, en ce qu'elle ne présente aucun point fixe.
Considérant qu'il y a 14 acres de terres labourables dépendantes et faisant partie du château et ferme du Taillis, non compris l'emplacement du château et autres bâtisses en dépendance comme cour d'honneur, abirynthe (sic), jardins fruitiers et potagers, ferme et masure, desquels le dit géomètre ne nous donne aucun plan ni détail sur celui qui nous a été présenté ;
| Il
résulte que d'après ces observations,
le conseil demanderait, à ce qu'il plaise à
Monsieur le sous-préfet, reporter la ligne de
délimitation entre Yainville et Le Trait à un
chemin ou est planté par Messieurs les agents forestiers le
poteau d'indication traversant la forêt du Trait et qui
conduit à la commune du Vaurouy et accédant
à la rivière de Seine en séparant la
masure et habitation de M. Le Leux, présentant
occupée par le sieur Dumenil, le tout situé
commune de Yainville, ce qui donnerait une ligne séparative
très directe entre ces deux communes. Le conseil se voyant en perte des terres susdites et dépendantes du château du Taillis et considérant que les communes de Duclair et Yainville ne peuvent donner à celle du Trait aucun terrain en récompense, pourquoi il demande à ce que la ligne de délimitation par lui proposée à Monsieur le sous-préfet soit acceptée autant que possible." Signèrent Jean Baptiste Boquet P. Leroy, Mabon, deux Tiphagne dont le maire, Lecornu, Baillif, Vautier, Renoult l'adjoint et Poullain. |
Annexer
Yainville
Dans
le même temps germa dans l'esprit du préfet
l'idée de rattacher Yainville au Trait. Le 17 octobre, il
pria le directeur des contributions directes de commettre le
géomètre pour dresser le plan figuratif des deux
communes. Plan qu'il transmit au secrétaire
général de préfecture puis aux
communes intéressées. Car il restait à
faire délibérer les deux conseils sur cette
éventuelle fusion.  Le baron Charles de Vanssay,
l'homme qui voulut rayer Yainville de la carte administrative.
|
Se fondre dans Le Trait ? Aussitôt la réponse d'Yainville fut négative. Négative... mais nuancée :
"Nous, maire, adjoint et membres du conseil municipal avons tous été d'avis de ce qui suit.
1°) Qu'il est d'absolue nécessité que Yainville continue de former une commune séparée.
2°) Que pour le culte, elle continue de rester attachée à Jumièges comme elle l'a été jusqu'à ce jour depuis le Concordat.
Et en se fondant sur les considérations suivantes, premièrement Yainville est une commune dont la population est agglomérée et séparée des autres communes par des terres en labour et conséquemment non munies d'habitations puisque les plus proches sont à près d'un quart de lieue et qu'il est nécessaire pour le maintien de l'ordre dans cette commune où la majeure partie des habitants sont peu fortunés qu'il existe des autorités pour veiller à leurs besoins et assurer la tranquillité publique.
On voit sur ce plan datant des années 20 que Yainville n'est pas résumé à son village. Une ferme isolée figure aux Fontaines, le quartier de Claquevent est développé et s'étend vers Le Trait.
Deuxièmement que Yainville, pour la religion, est réuni à Jumièges mais que pour le civil, Jumièges a plus de travail qu'il n'en faut pour lui donner un surcroit vu l'étendue et la population de sa commune. Mais, comme on l'a dit, Jumièges doit être le lieu de la religion pour les habitants de Yainville, attendu qu'ils ne connaissent depuis longtemps d'autre paroisse, qu'il existe à Jumièges un cimetière assez vaste où se font les inhumations des habitants de Yainville. Que cette vérité est tellement reconnue que Monsieur Le Sain, précédemment maire de Yainville, a donné en mourant dix mille francs à l'église de Jumièges si l'église de Yainville n'était pas rendue au culte.
Si, dans toute hypothèse, il devait y avoir une réunion qui serait très préjudiciable aux habitants et qui ne doit pas avoir lieu d'après leur vœu, ce serait à Jumièges que la préférence devrait être accordée."
En un mot : non au Trait. Oui au pire à Jumièges. Voilà qui fut délibéré le 3 décembre 1826 par Jean Aubé, Lafosse, Delépine, l'adjoint, Pierre Denis Varin, Rollain, le maire, Guilbert, Louis Gossé, Pinguet, Lambert, Jeanne et Metterie.
Rollain, le maire, est chaufournier et exploite après son père les carrières de Claquevent où l'on a compté une cinquantaine d'ouvriers. Il est le seul industriel de la commune vouée pour le reste à l'agriculture. Ce que dit Rollain du legs de l'ancien maire mérite d'être précisé. François Le Sain a bien laissé 10.000 F pour l'église de Jumièges qui devront être versés dans les quatre ans suivant la mort de sa veuve. Mais si entre temps l'église d'Yainville était rouverte au culte, alors la somme irait à cette dernière.
Le Trait pour la fusion
C'est le 4 janvier 1827 que la municipalité du Trait délibéra à son tour. Elle, est pour l'annexion.
1°) Considérant que la commune de Yainville, limitrophe de celle du Trait, après que tout son territoire enclavé dans icelle, que le surplus de terre qui se prolonge le long de la foêt du Trait jusqu'à la ferme du château du Taillis, que, plus, la commune d'Yainville a toujours faite en quelque sorte jonction avec celle du Trait puisque sous l'ancien régime, Messieurs les curés du Trait se qualifiaient de curé du Trait et Yainville, ainsi qu'il appert par toutes nos anciennes archives d'après leur signature.
2°) considérant que la commune du Trait peut sous tous les rapports accepter l'honorable propositon que veut bien lui faire Monsieur le préfet, en ce que l'église du Trait ainsi que son cimetière sont de grandeur plus qu'à suffire tant pour la piété des fidèles que pour leur sépulture puisque déjà les habitants de Yainville viennent à l'office au Trait et ont des bancs à loyer dans cette même église.
Ce fut délibéré par Vautier, Poullain, Bénard, Jean-Baptiste Boquet, Renoult l'adjoint, Baillif, Lecœur, les deux Tiphagne dont le maire et Mabon.
Les Traitons ont raison de dire que sous l'ancien régime, le curé du Trait se qualifie aussi d'Yainville. Mais ceci n'a jamais eu l'assentiment de l'abbaye de Jumièges qui, au contraire, protesta vivement en rappelant que l'église principale était bien celle d'Yainville et non du Trait. En vain...
Les Traitons affirment par ailleurs que les gens de Yainville assistent à l'office du Trait. Les Yainvillais, eux, nous disent qu'ils vont à Jumièges. Cette délibération est donc quelque peu mensongère. "Des" habitants d'Yainville et non point "Les" habitants d'Yainville se rendent certainement à Saint-Nicolas. Mais sans doute sagit-il de ceux qui résident en bas de la côte Béchère ou au village de Claquevent situé à peu de distance du vieux Trait.
Cette redoutable cote Béchère
Le 2 février 1827, les élus yainvillais se réunirent encore en mairie pour délibérer cette fois des nouvelles limites proposées avec la commune du Trait.
"Nous, maire et membre du conseil municipal soussignés avons été d'avis de ce qui suit, d'adopter les changements annoncés qui sont nécessités par les localités, le terrain indiqué pour être réuni à Yainville, marqué en rouge au plan pour 106 acres, doit par sa situation appartenir à Yainville et à Duclair dont la lettre n'indique la contenance pour chaque commune. On pense qu'il serait bon d'en réunir le plus possible à Yainville.
Cette commune peu importante a des besoins et en augmentant son extension, les derniers communaux pourraient devenir plus considérables tandis que les autres communes ont plus qu'à suffire en la comparant à elle. On doit d'autant mieux favoriser cette commune qu'il a été question de la réunir à une de celles voisines, chose que d'après les moyens fait valoir dans une précédente délibération, l'administration doit être à portée de juger pour ne pas avoir lieu.
On croit devoir dans cette présente délibération fournir à ce sujet de nouveau renseignements pour que Yainville forme une commune isolée. Sa population se trouve agglomérée en un même lieu qui est isolé des autres communes. La nouvelle route départementale la traverse, il existe quant à cette route une côte à l'entrée de Yainville en venant du Havre qui est très rapide et où il arrive de temps à autre des accidents. Il peut en arriver dans cet endroit de nature à mériter la présence de l'autorité locale. Ce motif seul doit être d'un certain poids auprès d'une administration sage qui a toujours mis son zéle à seconder les vœux de ses administrés."
La côte est appelée Bécher, à gauche de la route en direction du Trait. En face, elle porte le nom de Capron. Au lieu-dit Le Claquevent existait un relais de chevaux et une auberge. La ferme possède une mare importante. Ce quartier s'appelait aussi le Bout-du-Monde.
L'administration se gratta la tête. S'agissant des limites entre Yainville et Le Trait, il fallait revoir la copie. En revanche, rattacher Yainville au Trait, contrairement au préfet, le secrétaire général de préfecture n'était pas de cet avis. Lui, il voyait plutôt une annexion à Jumièges. Le préfet se rangea à cet avis. Restait à faire délibérer à nouveau les élus concernés.
Une pétition
Le 28 avril 1827, les Yainvillais déposèrent une pétition à Rouen.
A Monsieur le baron, conseiller d'État, De Vanssay, préfet de la Seine-Inférieure,
Les maire, habitants et propriétaires en la commune de Yainville ont l'honneur de vous exposer qu'il a été proposé de réunir leur commune à une autre. Monsieur le préfet, les soussignés ont l'honneur de vous faire les observations suivantes relativement à ce projet. Toute la population de Yainville se trouve réunie sur un seul point et se trouve séparée des habitants des communes voisines par des plaines très vastes,
que la population, quoi que peu nombreuse, exige qu'il ait au milieu d'elle une administration municipale par rapport à son isolement, que de plus elle se trouve traversée par la route départementale de Rouen au Havre et que là existe une descente de cote très périlleuse où il arrive fréquemment des accidents qui nécessitent l'intervention du maire qui, dans ce cas, serait placé à une distance trop éloignée pour qu'on put facilement obtenir sa présence en temps opportun, qu'en fin, Monsieur le préfet, le vœu des habitants est de continuer d'être administré comme ils ont été jusqu'à ce jour.
Quant au culte, ils n'ont pas encore perdu l'espoir que leur église ne pourra être rétablie, mais toujours est-il qu'il existe au milieu d'eux pour l'ordre et leur tranquillité une administration civile.
D'après ces motifs, Monsieur le préfet, ils osent espérer que vous voudrez bien seconder leur demande."
Et c'est signé Rollain maire, Varin, Metterie, Gossé, Delépine, Guillevert, Pinguet, Lafosse, Jeanne, Lambert, Jeanne, Jean Aubé, bref le conseil. Seules signatures nouvelles : Longuemare, M. Boisguillaume, Grain, Hüe et un paraphe illisible.
A Rouen, on reçut cette pétition non sans intérêt. Mais avec un reproche : celui de n'avoir pas reçu la délibération du conseil à ce sujet.
Du coup, les Yainvillais se réunirent à nouveau le 27 juillet 1827 pour développer les mêmes arguments. Le caractère isolé, la cote Béchère nécessitant une administration... Et on ajoute : "Si pour se procurer cette autorité ont fut obligé d'avoir recours au Trait ou à Jumièges, ce serait préjudicier d'une manière forte les intérêts des voyageurs et le service des entrepreneurs."
Jumièges est pour
Le 5 septembre 1827, ce fut autour de Jumièges de dire si, déjà réunie pour le spirituel, Yainville pouvait l'être pour le temporel :
"Nous avons tous été d'avis unanime que, vu l'exiguïté du territoire et le peu de population de la commune, en la réunissant à Jumièges, ce sera rendre cette commune un peu plus importante et simplifiera la correspondance avec l'administration supérieure."
Signent Desjadins, J n a Bouttard, Dupont, Chantin, Jean Deconihout, Porgueroult, Poisson, P. Dossemont, Dossier et Le Sain, maire. Diable de Le Sain ! Il est le cousin du premier maire d'Yainville, l'héritier de celui qui, a sa mort, avait fait un don pour que soit relevée l'église Saint-André. Comme on le verra plus loin, Charles Le Sain n'est pas à une contradiction près.
On en resta là et quelques années passèrent. Que stipulait le testament du premier maire d'Yainville ?
M. François Lesain a légué à M. Charles Lesain, son cousin issu de germain demeurant à Jumièges les biens fonds appartenant au testateur situés tant en la commune de Yainville qu'en celle de Jumièges à l'exception de ceux qui se trouvent au hameau d'Heurteauville à la charge par M. Lesain, légataire :
1° de laisser jouir en usufruit des dits biens madame Marie Anne Deshayes, épouse du testateur et
2° de payer une somme de dix mille francs à la fabrique de Jumièges, quatre ans après le décès de l'épouse de M. Lesain, testateur, pour être, la dite somme, employée à avoir deux cloches et autres ornements avec stipulation toutefois que si l'église d'Yainville venait à être rétablie avant la dite époque, cette somme de dix mille francs irait au profit de la fabrique d'Yainville.
Destitué en 1830 de ses fonctions de maire de Jumièges, Charles Lesain, l'heureux héritier avait fini par quitter sa maison, située près de l'église Saint-Valentin pour s'installer dans le manoir d'Yainville. Où il fut nommé encore maire à la surprise générale. C'était en 1839. Il se disait de lui que, quelques années plus tôt, il avait menacé de mort le médecin et le clerc de notaire de Jumièges surpris à braconner sur ses terres, qu'il avait voté dans un collège électoral où il n'était pas inscrit, ce qui lui avait valu sa destitution. Du temps même où il n'était encore qu'adjoint de Jumièges, on disait déjà pis que pendre de lui. Voici comment, en 1822, le voyait Desaulty, un ancien moine piqué de politique : "il est âgé de 26 ans, il fait valoir à ferme 15 acres de terre qui lui donnent le temps de chasser tous les jours de l'année, que la chasse soit ou fermée ou ouverte. Il ne respecte les grains de personne et c'est plus que scandaleux qu'un homme revêtu du caractère d'administrateur de la commune s'y comporte aussi mal. Il ne vit point avec sa femme qui habite une autre maison que la sienne. Il se permet des voies de fait envers sa mère quand elle lui fait observer sa conduite. Ce dernier est indigne d'être maire ! " Il le fut pourtant. Deux fois.
Sauver l'église c'est sauver Yainville

Le 23 juillet 1842, la veuve du premier maire d'Yainville vint à mourir. Charles Lesain avait donc quatre ans devant lui pour verser les 10.000 F promis à la paroisse de Jumièges. A moins qu'entre temps celle d'Yainville ne soit relevée. Or, elle était toujours en ruines. Ces dispositions testamentaires étaient parfaitement connues. Aussi, l'idée de lancer une souscription pour restaurer Saint-André se dessine dans l'esprit de certains Yainvillais. D'autant que, de son côté, Mlle Delafenestre est prête à léguer son presbytère. A leurs yeux, sauver l'église, c'est sauver la commune.
Or Le Sain, son adjoint et son fermier vont s'opposer à ce projet tout en refusant le don de l'ancien presbytère. Le 20 octobre 1843, ils imposent une délibération préparée à l'avance et veulent la faire adopter au reste du conseil. Leurs arguments ? "La commune d'Yainville est réunie pour le culte à la commune de Jumièges dont elle n'est séparée que d'un kilomètre et demi à peine." Et personne ne s'en plaint. Les chemins sont faciles et les curés de Jumièges se sont toujours parfaitement acquitté de leur tâche à l'égard des Yainvillais. Voilà qui milite pour l'annexion. Lesain va plus loin : l'église délabrée est propriété de la fabrique de Jumièges. Et ce n'est pas le devis obtenu par les partisans de sa reconstruction qui couvrira les frais. Le legs aussi appartient à Jumièges. Car même si l'église était réparée, elle n'aurait pas de fabrique ni d'existence légale. Ce qui ne va pas dans le sens de la pensée de François Lesain lorsqu'il rédigea son testament.
Les six conseillers formant la majorité du conseil refusent de signer une telle capitulation. Quant à Thuillier, cousin du maire, il se tait. Seuls François Pierre Mabon, l'adjoint de le Sain et son fermier, Pierre Amable Duval, défendent la position du premier magistrat. Entre ces trois hommes et le reste du conseil, la guerre est ouverte.
Un "shadow cabinet"
Les partisans de la restauration de l'église sont aussi des adeptes de la Restauration tout court. Ils vont tenir des réunions chez l'un d'entre eux. Ainsi Yainville aura-t-il deux conseils municipaux. Schématiquement, celui des monarchistes contre les fidèles d'un maire soit-disant républicain après avoir été royaliste bon teint. Cette fronde va faire pleuvoir des lettres de dénonciation sur la préfecture. On accuse Lesain d'avoir pratiqué trois ouvertures de sa propriété vers le cimetière. Si bien que des animaux voraces y divaguent au préjudice des trépassés. Jean-Laurent Delépine a été destitué par Lesain de son grade de lieutenant de la garde nationale. Le maire a nommé a sa place son propre fermier, Duval. Depuis, la garde nationale n'est plus convoquée. Du coup, Delépine a la dent dure. Il accuse notamment Lesain de s'être accaparé le chemin qui mène du Trait à Jumièges, en bordure de Seine.
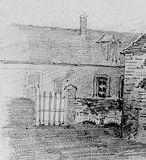
Cette
gravure montre l'une
des ouvertures
pratiquées par Lesain pour accéder au cimetière.
pratiquées par Lesain pour accéder au cimetière.
Lesain, assurent ses ennemis, pratique la fraude électorale. Il nomme son fils secrétaire lors des scrutins et ce dernier inscrit des noms contraires à ceux formulés par les électeurs illettrés. Lesain braconne, empoisonne la campagne avec ses pigeons... Une pétition de 38 signatures fut adressée au préfet pour exiger sa destitution.
Dans le même temps, les Antiquaires de Normandie défendaient la restauration de l'église. En juillet 1843, ils s'inquiètent en effet de la rumeur d'une destruction imminente de l'édifice et dépêchent sur place MM Rondeaux et De la Querière. "Ils ont été accueillis par le conseil municipal qui leur a exprimé le vif désir de voir cette église réparée." Manifestement, le Sain n'est pas là...
"Plusieurs habitants
ont promis de concourir aux réparations par leur travail et
par le don de matériaux. Un habitant riche a
légué 10,000 fr. pour l'église si elle
est rendue au culte ; dans le cas contraire, cette somme serait
dévolue à celle de Jumiéges pour y
placer des cloches.
Cette église est un dernier spécimen de
l'état de l'art au XIe siècle, et
mérite d'être conservée.
D'un autre côté, l'ancien presbytère a
été restitué à la commune
par un legs de la dernière propriétaire.
La Commission invite M. de la Quérière
à se charger de rédiger le rapport qu'il lui
parait convenable d'adresser à M. le Préfet
à cet égard."
| Seul
contre
tous, Lesain revint sur sa position en décembre 1843. Il
était temps, une enquête du juge de Paix ne lui
était guère favorable. Seulement, il s'agit
là d'un revirement de façade. Lesain refuse
toujours le legs de feue Mlle Delefenêtre et le
presbytère va être vendu par ses
héritiers. Quand ont vint chez Lesain pour recueillir sa
souscription ainsi que celle de ses deux affidés, la
délégation fut reçu par des injures.
En quittant le cimetière par la principale
entrée, nos hommes faillirent s'affaler. Une corde
était tendue en travers des marches, sans doute pour faire
chute celui qui, matin et soir, venait sonner l'angélus. Le
24 décembre, le fils du maire bat le rappel à son
de caisse. Il exhorte la population à ne pas payer leur
souscription pour la restauration de l'église. Du coup, les
six conseillers frondeurs menacent de démissionner en bloc. Quand vint 1844, on vota les sommes nécessaires à l'acquisition de vases sacrés, linges et ornements pour l'église. |
Ce
même mois de décembre, la presse nationale s'est
emparée de l'affaire. Le
Journal des débats du 9
décembre 1843 : « L'église d'Yainville est remarquable par son antiquité. Depuis plus de quarante ans elle était abandonnée et elle tombait en ruines, lorsque la sollicitude de M. le préfet de la Seine-Inférieure fut éveillée, non seulement par les plaintes des habitans, mais encore par une souscription où les plus pauvres se cotisèrent pour obtenir la conservation de leur église et du cimetière où reposent les cendres de leurs pères. Divers incidens compliquaient cette question, et des débats s'étaient engagés pendant lesquels la destruction de l'édifice serait devenu complète. M. le ministre de l'Intérieur a tranché toutes ces difficultés par une décision qui sera louée par les gens de bien, et qui sera reçue avec acclamations dans ce petit pays ; il a accueilli la demande de M. le préfet, en inscrivant provisoirement l'église d'Yainville sur la liste des monumens historiques, et en autorisant le magistrat à ordonner d'urgence les travaux de réparation que réclame cet édifice. » M. le préfet va procéder aux informations nécessaires pour que, sur le rapport de la commission des monumens historiques, le ministre de l'intérieur puisse prononcer définitivement, s'il y a lieu, le maintien de l'église d'Yainville parmi les anciens monumens de la Normandie. » |
Jumièges rallume la guerre
| C'est dans un
tel contexte que le conseil municipal de Jumièges ralluma la
guerre en demandant, le 6 novembre 1844, l'annexion d'Yainville. "Le conseil, à l'unanimité, demande la réunion à Jumièges de la commune d'Yainville et il rappelle à ce sujet qu'une délibération du 5 septembre 1827 avait déjà demandé cette réunion qui paraît être dans l'intérêt des deux communes et d'une bonne administration." Les auteurs de ce vœu ? Chantin, maire, Philippe et Dupont, premier et second adjoints, Heuzé, Dossier, Virvaux, Ouin, Lefebvre, Mallet, Fauvelle et Maître Bicheray, le notaire qui faisait ce jour-là office de secrétaire de séance. |
On se souviendra de tous les efforts tentés en 1844 par la Commission des Antiquités "pour conserver au pays la charmante église d'Yainville, menacée alors d'une ruine imminente par la fabrique de Jumiéges. La Commission se rappellera sans doute avec plaisir la mission confiée par elle à MM. Rondeaux et De la Quérière, et le touchant récit que ces deux membres lui firent de leur visite à Yainville, visite et mission auxquelles l'église doit son salut, car, de ce moment, M. le baron Dupont-Delporte, Préfet de la Seine-Inférieure, défendit à la fabrique de Jumièges de vendre ou de démolir ce monument, et, en 1845, M.J. Rondeaux, étant député obtint par ses démarches et son crédit, l'érection de cette église en succursale, ce qui la met en sûreté pour toujours. " |
Le 17 juin 1845, le conseil d'Yainville fut invité à de prononcer sur le souhait de Jumièges. Ce qui fut fait le 25 :
"La majorité dit que si la réunion d'Yainville à Jumièges avait lieu, elle serait pour eux très préjudiciable. Il vote le rejet de cette demande, attendu que la commune de Jumièges est, par rapport à sa nombreuse population et l'étendue de son territoire, l'une des plus grandes du département et qu'il en résulterait pour elle aucun avantage.
Le conseil demande en réunion à Yainville la moitié du hameau d'Herteauville à partir du bureau de la chapelle du Bout-du-Vent jusqu'aux limites de la commune de Guerbaville.
Signent Lambert, Lafosse, Jeanne, Pinguet, Metterie et Lesain, maire.
Quand cette délibération parvint à Rouen, un main la commenta dans la marge : "Herteauville est de l'autre côté de la Seine, cela ne peut se faire. Ce hameau devrait faire partie de Guerbaville et Yainville ainsi que le Mesnil devraient être réunis à Jumièges." Carrément ! Après tout, ce fonctionnaire ne faisait que reconstituer l'ancienne baronnie de Jumièges. Les trois paroisses de la presqu'île formaient en effet le domaine direct de l'abbaye.
Des vues sur Heurteauville
 Puisque
Jumièges voulait Yainville, Yainville répliqua en
revendiquant une partie du territoire de Jumièges. Les
dissidents s'adressèrent au baron Dupont-Delporte,
préfet, qui, sensibles à leurs argument, va
autoriser le rétablissement de l'église.
Puisque
Jumièges voulait Yainville, Yainville répliqua en
revendiquant une partie du territoire de Jumièges. Les
dissidents s'adressèrent au baron Dupont-Delporte,
préfet, qui, sensibles à leurs argument, va
autoriser le rétablissement de l'église."Nous membres du conseil municipal de la commune d'Yainville, vu la délibération qui a été prise à notre insu et sans notre consentement au sujet de notre réunion à la commune de Jumièges, nous avons cru devoir sur votre parole nous réunir pour faire une délibération en date du 26 juin dernier (...) dans laquelle nous vous manifestons que nous ne consentons point et que nous ne consentirons jamais à cette réunion. D'un autre côté, ignorants et ayant sujet de craindre que cette nouvelle délibération ne vous demeure inconnue, c'est pourquoi nous avons pris la liberté de vous écrire cette lettre à titre particulier avec que vous nous fassiez connaître si vous l'avez reçue et vous prier de bien vouloir favoriser la demande que nous vous avons faite..."
Cette fois, c'est signé Metterie, Lafosse, Pinguet, Lambert et Jeanne. Mais pas Lesain qui se contente de transmettre la délibération sans l'honorer de son paraphe.
Le maire ne va plus se manifester pour garder son écharpe et l'on peut s'interroger sur sa position. Né à Jumièges, marié à Jumièges où il a toujours du bien, à quel jeu se livre donc le maire d'Yainville ? N'oublions pas qu'en qualité de maire de Jumièges, il avait été favorable à la fusion. Ce sont donc ceux qui défendent la paroisse qui défendent aussi la commune. Et ce combat, il est mené par des monarchistes...
Dans sa session de 1845, le conseil d'arrondissement de Rouen réunit une commission composée de MM. Flavigny, Rondeaux, Caumont, de Monville, de Saint-Léger et Keittinger. "La commission qui a examiné la demande de réunion d'Yainville à Jumièges expose que Yainville est déjà réuni à Jumièges quant au culte et à l'instruction primaire, que la principale voie de communication de Jumièges à Rouen et à Caudebec traverse le village d'Yainville dont le territoire est aussi rapproché du bourg de Jumièges que les hameaux ou sections d'Heurteauville et de Conihout dépendant de Jumièges qui possède une population de 1.678 habitants.
Enfin qu'Yainville qui ne compte que 210 habitants, qui ne jouit d'aucun revenu, se trouve dans la catégorie des communes à l'égard desquelles le conseil d'arrondissement de Rouen a émis le vœu de leur réunion aux communes limitrophes.
Cette réunion offrirait plus de garantie pour une bonne administration municipale en même temps qu'elle en diminuerait sensiblement les frais.
Mais attendu que l'instruction n'a pa encore être complétée sur la réunion dont il est question, la commission estime qu'il y a lieu d'engager l'administration à poursuivre cette instruction.
En attendant, la procédure suivait son cours. L'agent voyer d'arrondissement dressa un plan d'assemblage en juillet 1845 et réclama son dû. On estima ses trois vacations à 24F.
Le conseil d'arrondissement penchait pour la réunion mais il restait à diligenter une enquête publique. Celle-ci fut confiée à Depeaux, le juge de Paix du canton de Duclair en qualité de délégué de l'administration. A lui d'entendre les habitants des deux communes, à lui d'apporter ses conclusions personnelles. Après quoi, il faudra de nouveau faire délibérer les deux conseils.
Le 23 août, les conseillers d'Yainville, toujours sans Lesain, adressèrent une nouvelle lettre au baron Delaporte, préfet pour lui exposer "qu'ils sont informés que de nouvelles démarches sont sur le point d'être faites auprès de vous pour obtenir la réunion de la commune de Yainville à celle de Jumièges.
Que néanmoins cette réunion est combattue par la presque totalité des habitants de Yainville qui demandent au contraire à jouir de tous droits.
Que si la dite réunion pouvait avoir lieu, il en résulterait des discussions entre les administrations et il est sage de prévenir toute division à cet égard.
Que la loi sur l'administration municipale a prévu les cas dans lesquels il pourrait y avoir lieu à réunion de communes. L'on conçoit en effet qu'une commune qui ne serait peuplée que de 150 habitants et même moins devrait être réunie à une commune plus nombreuse en nombre, à cause des difficultés qu'on éprouverait à lui (trouver) une administration municipale, mais Yainville ne se trouve pas dans cette position et quoi qu'on a bien voulu dire qu'elle ne comptait que 210 habitants, il résulte au contraire d'un nouveau recensement que les soussignés ont dressé avec la plus scrupuleuse exactitude que leur commune renferme trois cent quatre habitants qui certes peuvent par eux-mêmes administrer leurs affaires.
Que Monsieur le préfet veuille bien remarquer que Yainville est distant de Jumièges de trois quarts de lieue et l'on conçoit que si l'état-civil se trouvait porté aussi loin les entraves et les embarras qu'éprouveraient les habitants de Yainville.
Si l'on trouve que la commune de Yainville n'était pas suffisamment peuplée, il y a un moyen de remédier à cet inconvénient sans nuire en rien aux droits et prérogatives sont ont joui ses habitants jusqu'à ce jour. Ce moyen consisterait à réunir à Yainville le hameau de "Heurtoville" ou au moins la moitié de ce hameau qui se trouve plus rapproché de Yainville que de Jumièges. Ce cette manière, toutes les exigences se trouveraient satisfaites.
C'est dans de semblables circonstances que les soussignés déclarent formellement protester contre la jonction des communes de Yainville et Jumièges et qu'ils vous prient, Monsieur le préfet, de rejeter toutes demandes contraires. "
Signé Metterie, Jeanne, Lafosse Pinguet, Lambert et Delépine.
La lettre est d'une écriture alerte, sans les fautes commises habituellement par les conseillers. Qui a tenu la plume ? Mystère.
L'abandon de la procédure
Le 4 octobre 1845, la municipalité de Jumièges vota, unanime, en faveur des 24F réclamés par M. Masqueray, l'agent voyer de l'arrondissement. 24 F de perdus. Car si cette délibération fut approuvée par l'administration rouennaise, elle n'allait servir à rien...
Le 11 décembre, le juge de Paix du canton au préfet qui lui avait laissé le choix du laps de temps et du lieu nécessaire à son enquête publique. "C'est sur ce dernier point que j'ai l'honneur de vous prier de m'éclairer en me disant si, vu la mauvaise saison et la difficulté des déplacements augmentée par mes 72 ans, je pourrais indiquer mon domicile pour y réunir, pendant un mis plus et trois jours par semaine les déclarations des habitants des communes intéressées."
Le 13 décembre, la division des finances, 1er bureau, lui répond : "Le conseil général se montre fort pu disposé à admettre les demandes en réunion de communes parce qu'il lui est toujours difficile d'apprécier la plus ou moins grande facilité des relations que doivent ouvrir entre elles les différentes masses d'habitations. C'est effectivement un obstacle qui s'oppose le plus souvent à ce que ces demandes soient favorablement accueillies. Ce n'est donc que lorsqu'il se présente ses cas de nécessité absolue que le conseil général peut déroger aux principes qui sont pour lui d'usage de suivre dans l'espèce. Or, dans l'état actuel des choses, le projet de réunion d'Yainville à Jumièges à l'occasion duquel je vous avais prié de diriger l'enquête prescrite par l'article 2 de la loi du 18 juillet 1837 ne paraissant pas rentrer dans les cas d'exception dont il s'agit, je viens, après nouvel examen, de décider qu'il n'y serait pas donné suite quant à présent...."
En janvier 1846, notre vieux juge de Paix renvoya donc à Rouen les pièces du dossier. Lesain démissionna le mois suivant. Ce n'est qu'en 1854 qu'il versa les 10.000 F à la nouvelle fabrique de la paroisse. Car Yainville rouvrit son église, créa une école, développera son industrie en bord de Seine. Son indépendance était assurée.
Laurent QUEVILLY.
SOURCE
Dossier 1M90 numérisé aux
archives départementales par Jean-Yves et Josiane Marchand.

